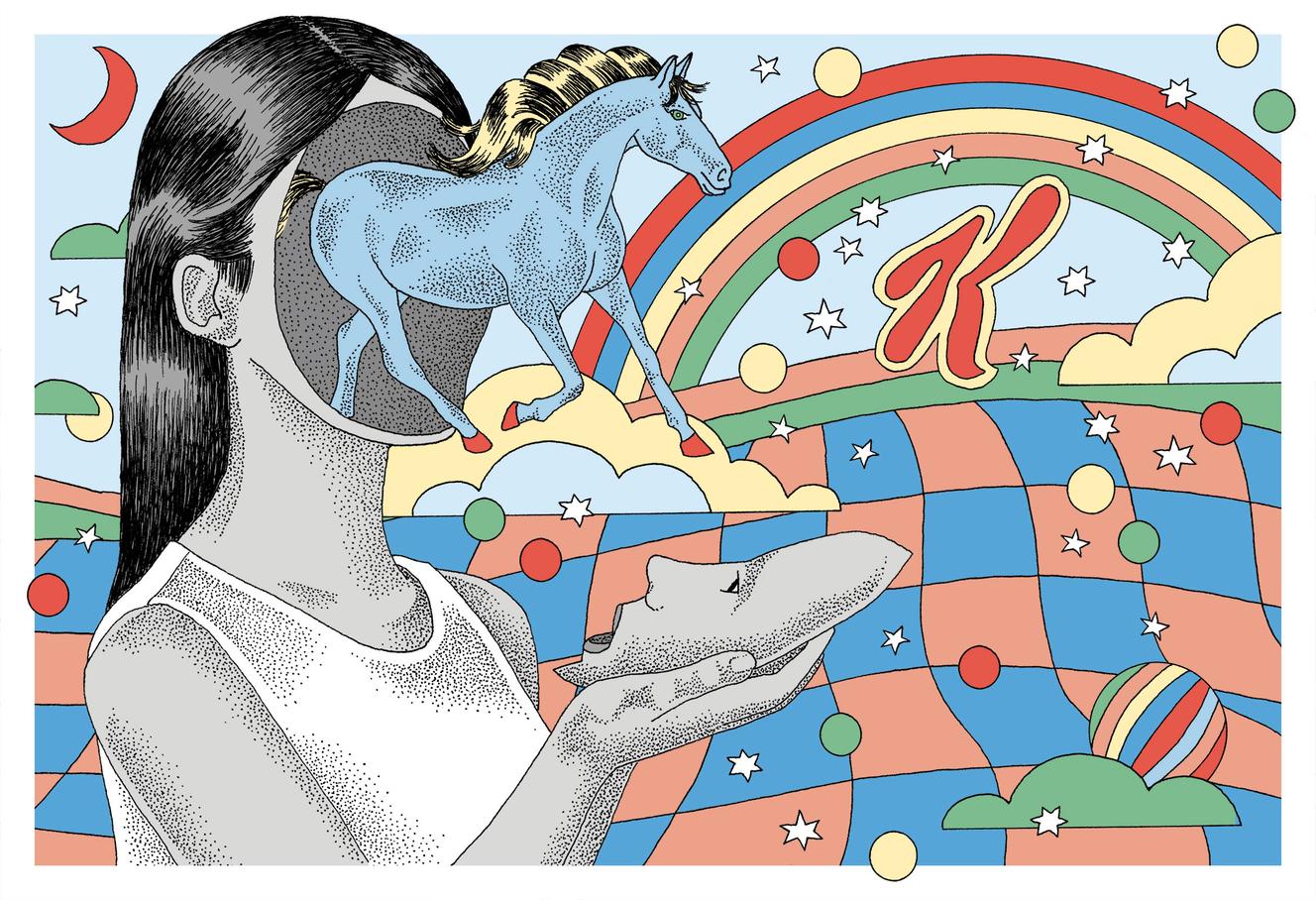Rhône et lac Léman : accords franco-suisses historiques face à l’urgence climatique
Face à l'accroissement des risques associés au réchauffement climatique, la France et la Suisse ont signé, ce jeudi à Genève, deux accords sur la gestion des eaux du lac Léman et du Rhône. L’enjeu : mieux faire face aux crises à venir et arbitrer entre les usages des eaux.

La France aura désormais son mot à dire sur la gestion du Léman et du Rhône, après des années de négociation. L’avancée est historique : depuis 1884, la Suisse gérait seule les niveaux du Léman.
Face aux effets du changement climatique qui perturbent les différents usages de ces ressources, ces textes, issus de deux années de négociations bilatérales, visent à améliorer la coopération autour du niveau du lac Léman et à créer une commission dédiée au Rhône. L’objectif est de mieux anticiper et atténuer les conséquences des crues et des sécheresses, dont la fréquence et l’intensité s’accentuent et, à long terme, anticiper la fonte des glaciers. Les deux accords signés ce matin devraient permettre de mieux prévenir les risques et prévoir une meilleure coopération transfrontalières.
Un fleuve majeur né dans un glacier suisse
Fleuve majeur européen, le Rhône, né d’un glacier alpin qui porte son nom, entame son parcours en Suisse avant de traverser le Léman, la plus grande réserve d’eau de surface d’Europe occidentale, pour ensuite s’écouler en France.

Parcours Rhône / infographie TV5MONDE
Mais le visage du fleuve est en train de changer.
Avec la disparition progressive des glaciers, le Rhône sera de plus en plus dépendant des eaux de pluie.
Laurent Saint-Martin, ministre français délégué au Commerce extérieur
Une évolution qui rendra son débit bien plus imprévisible, augmentant les risques de crues soudaines comme de périodes d’étiage, ces phases où le niveau de l’eau atteint des seuils exceptionnellement bas. Un enjeu de taille, car le Léman et le Rhône alimentent une multitude d’usages cruciaux : navigation, pêche, agriculture, loisirs, énergie hydroélectrique, production d’eau potable, mais aussi refroidissement de quatre centrales nucléaires françaises et ralentissement de la salinisation du delta en Camargue.
Les premiers échanges officiels entre la France et la Suisse sur la gouvernance des eaux du Rhône ont été initiés en 2011. Cette année-là, un épisode de sécheresse sévère qui avait mis en difficulté la centrale nucléaire du Bugey, en France, incapable de garantir un refroidissement optimal. En réponse à la baisse du niveau du Léman, Genève avait décidé de réduire le débit du Rhône, exposant les limites d’une gestion unilatérale et les tensions potentielles entre usages énergétiques, environnementaux et urbains. En 2023, la Suisse s'est dite "prête à négocier", aboutissant deux ans plus tard à la signature de ces deux accords.
Que contiennent ces deux accords ?
le premier texte est un accord sur la régularisation des eaux du Léman, qui comporte "un dispositif binational" avec des "cellules franco-suisses de gestion de crises qui seront activées dès lors que certains seuils quantitatifs seront dépassés ou menaceront d'être dépassés, qu'il s'agisse du niveau du lac ou du débit du Rhône", a expliqué M. Saint-Martin.
C’est la vraie l’avancée selon moi. Avant, ces niveaux n’étaient gérés que par la Suisse, mais aujourd’hui, il y a un cadre qui amène d’une part plus de flexibilité, c’est-à-dire que la France est formellement considérée. D’autre part, il prévoit une anticipation de la gestion de crise, ce qui est particulièrement important dans le contexte actuel de changement climatique.
Christian Bréthaut, professeur associé en gouvernance de l’eau au Département géographie et environnement et à l’Institut des Sciences de l’Environnement de l’Université de Genève.
Le deuxième texte est un accord, relatif à la coopération sur les eaux transfrontières du Rhône, qui met en place une Commission de coopération bilatérale avec une présidence alternée entre les deux pays. Il s’agit d’un outil de coordination entre les différents acteurs : les politiques, les scientifiques, les services et agences des eaux français et suisse.
"Sa tâche est d'apporter une vision commune, de faciliter la gestion des eaux transfrontalières du Rhône entre instances existantes, d'identifier les défis actuels et futurs en lien avec la gestion de l'eau et, le cas échéant, proposer la mise en place d’instances complémentaires", selon un communiqué du ministère suisse de l'Environnement, des Transports et de l'Energie.
Auparavant, il n’y avait aucun mécanisme sur les enjeux quantitatifs, notamment sur le niveau du Lac Léman.
« C’était une anomalie totale. Le Rhône est un fleuve majeur, l’un des plus stratégique et exploité d’Europe. Tous les autres fleuves européens disposent depuis de nombreuses années de plateforme ou de cadres. Et avec le changement climatique, on a pris conscience qu’il fallait mieux formaliser ces risques ».
Christian Bréthaut, professeur associé en gouvernance de l’eau au Département géographie et environnement et à l’Institut des Sciences de l’Environnement de l’Université de Genève.
En quoi est-ce une avancée ?
La simple existence d’un cadre institutionnel permet de mieux anticiper les crises. Mais on reste dans un cadre curatif, qui ne fait pas de la planification préventive, regrette Christian Bréthaut.
On a manqué une occasion de repenser notre lien au fleuve Rhône et à ses usages de façon collective. On reste dans une utilisation très centrée sur les besoins humains, sans prendre en compte la préservation des écosystèmes.Christian Bréthaut, professeur associé en gouvernance de l’eau au Département géographie et environnement et à l’Institut des Sciences de l’Environnement de l’Université de Genève.
Un autre accord est en discussion entre Berne et Paris sur le Doubs, les négociations devraient bientôt aboutir.
[Source: TV5Monde]