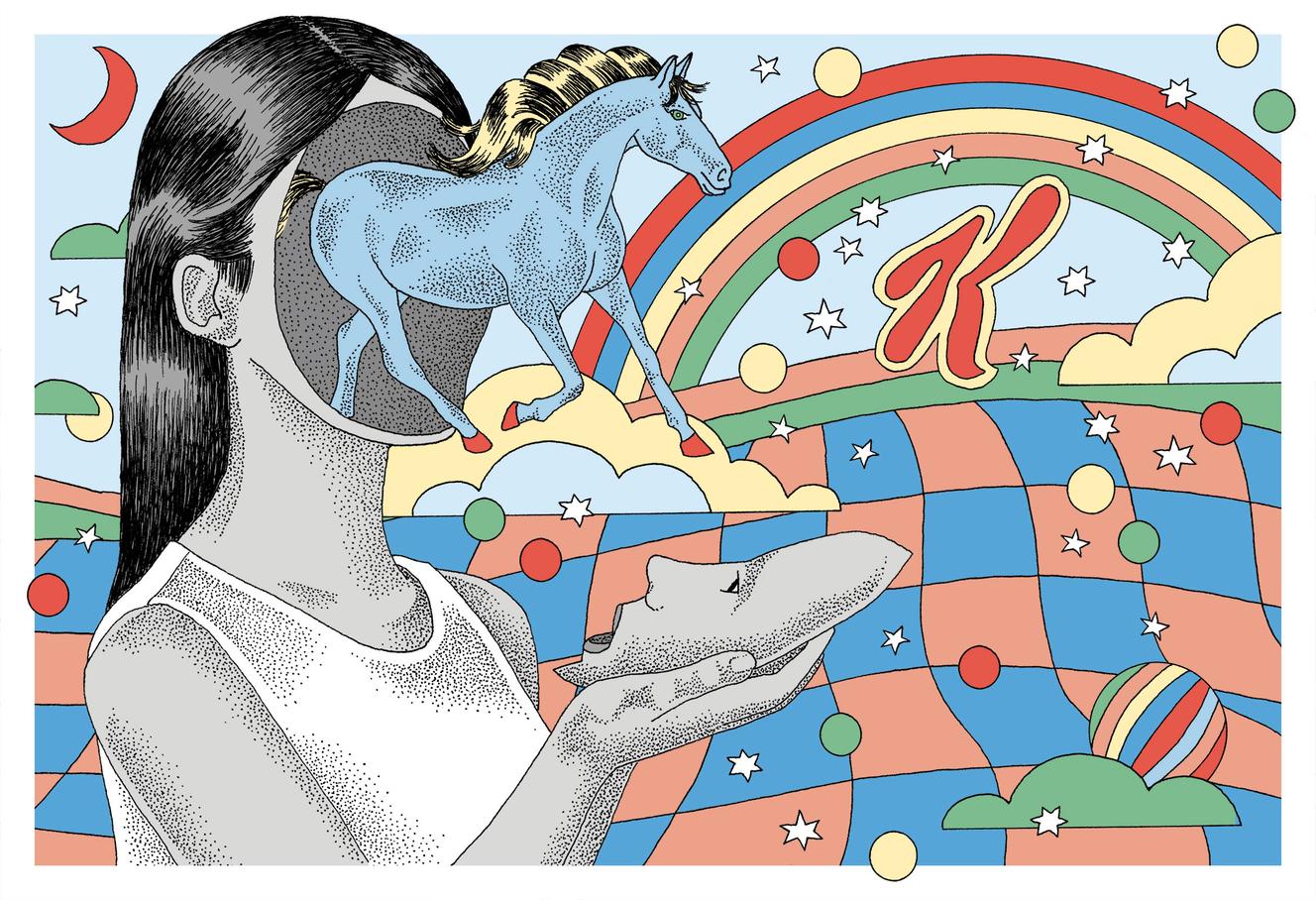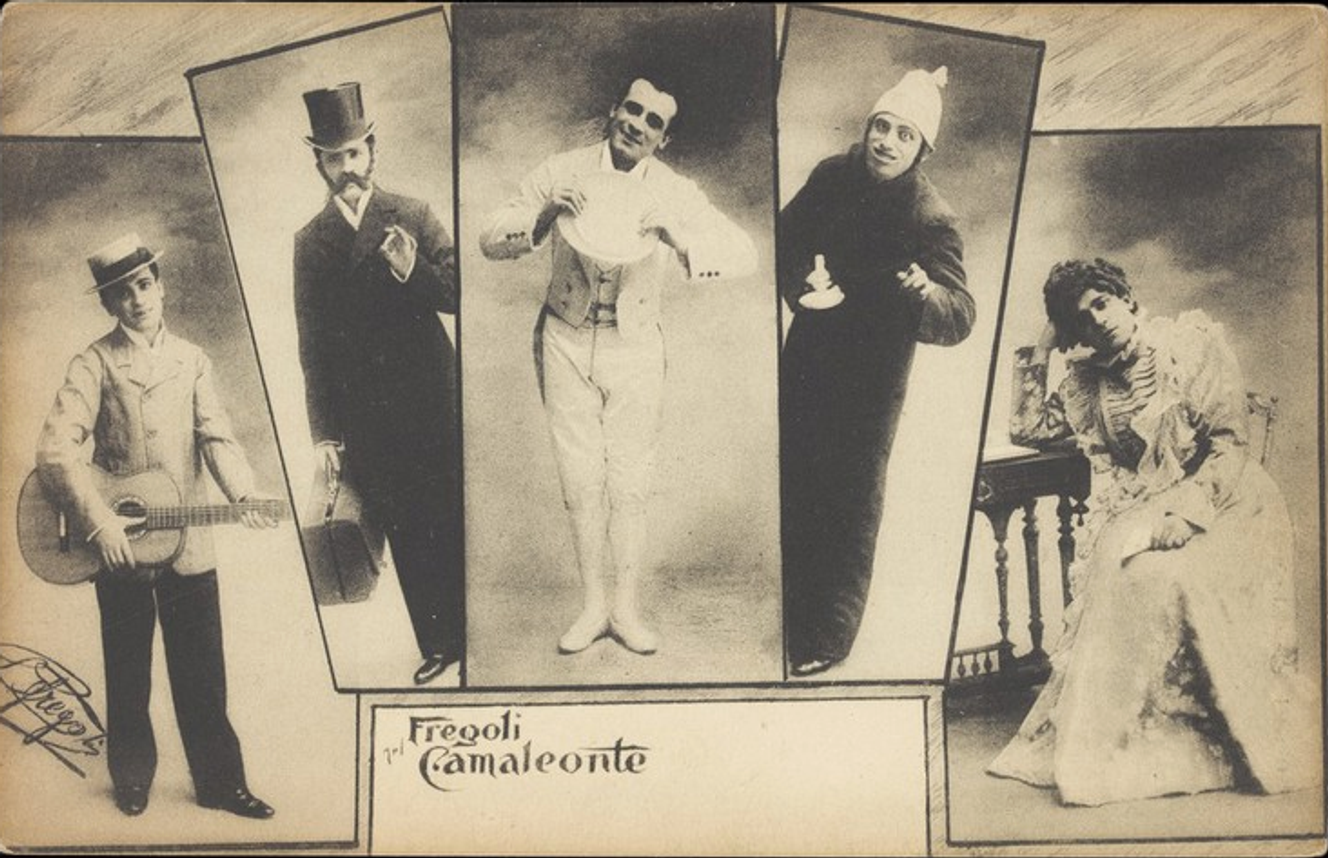Au Pakistan, le déclin de la vallée de la Hunza : « En à peine vingt ans, tout notre environnement a changé »
Dans le nord du pays, les habitants de villages restés isolés du monde extérieur durant des siècles subissent les effets conjugués du raccordement au reste du territoire et du réchauffement climatique, à l’origine de diverses catastrophes.

La route est à peine dessinée sur les cartes. Située dans l’extrême nord du Pakistan, à un jet de pierre de la frontière chinoise, elle mène à Shimshal, le plus haut village de la vallée de la Hunza. L’itinéraire débute au pied de la chaîne du Karakoram et de son chapelet de montagnes en forme de cônes, des cathédrales naturelles, pointues comme des aiguilles, à la beauté époustouflante.
Dans le village de Passu, on quitte la confortable « Karakoram Highway », la nationale mise en service au début des années 1980 pour relier la Chine au Pakistan. Le 4 x 4 emprunte alors un premier pont suspendu qui marque le début de l’ascension vers Shimshal. En contrebas, une poignée d’hommes, des chercheurs d’or, s’affairent dans la rivière tumultueuse et grisâtre, nourrie par la fonte des glaciers. Une vague de chaleur, en cette fin mai, s’est abattue sur le Pakistan et n’épargne pas le haut Himalaya.
La piste est étroite, en terre et en gravier ; elle s’enfonce dans un défilé de gorges rocailleuses, puis franchit des vallées dégarnies aux parois sculptées par le vent comme des forts naturels, longe des glaciers couleur noir cendre recouverts de sédiments. Ce désert minéral et fragile s’effrite de toutes parts. La dernière portion du voyage, en bordure de précipice, sera un supplice : les roues du véhicule frôlent le vide et les flancs de la montagne.
Shimshal surgit enfin après trois heures et demie et 55 kilomètres de poussière, telle une oasis de verdure. Ses chemins bordés de peupliers, ses vergers (cerisiers, pêchers, abricotiers), ses champs de blé et ses parcelles de légumes délimités par des murets en pierre composent un patchwork naturel luxuriant avec, en fond sonore, le seul bruit de l’eau des glaciers dévalant le labyrinthe des canaux d’irrigation. Au loin, les sommets brillent de leurs neiges éternelles. Shimshal a des airs de jardin d’Eden.
Perché à 3 100 mètres d’altitude, ce bourg peuplé d’un peu moins de 2 000 Wakhi, une tribu d’origine indo-iranienne dispersée entre le Pakistan, l’Afghanistan, le Tadjikistan et la Chine, a vu la première voiture pointer à l’horizon en 2003. Jusque-là, cette communauté agropastorale vivait en complète autarcie, ignorant presque tout du monde extérieur. Shimshal, il y a encore deux décennies, ne connaissait ni l’électricité, ni le téléphone, ni les machines à laver, encore moins les ordinateurs et Internet.
« Symbiose avec la nature »
Pour survivre aux hivers rigoureux, les familles, autosuffisantes, cultivaient et stockaient des céréales, du blé, de l’orge, du millet, des pois noirs, des pommes de terre. Elles fabriquaient du fromage et du beurre avec le lait de leurs bêtes (yaks, brebis, chèvres) et faisaient sécher leurs abricots et leurs noix – bases de leur alimentation. Les noyaux d’abricot étaient pressés pour en extraire de l’huile. Le village n’avait accès à aucun produit transformé, il ne connaissait pas le sucre.
Sans doute les hommes avaient-ils perçu quelques échos de la vie moderne, quand ils descendaient à Passu pour se ravitailler en thé, sel et riz. Le voyage nécessitait à la descente trois jours entiers de marche dans la rocaille. Il fallait franchir trois cols et traverser à neuf reprises des rivières glaciales. Le retour, le dos lesté d’une trentaine de kilos, prenait une journée de plus. Malgré ces brèves incursions dans « l’autre monde », rien ne pouvait altérer la vie ancestrale des Shimshalis.
« C’était une vie difficile, âpre, mais parfaitement saine et en symbiose avec la nature, confie Mohamed Amin, un professeur à la retraite. Nous n’avions rien. On ne mangeait que ce que nous étions capables de produire, tout était pur, biologique, sans aucun produit chimique. » Chaque été, les familles migraient avec leurs troupeaux sur les pâturages du Pamir, à 4 735 mètres d’altitude, jusqu’à l’arrivée de l’hiver. Hommes et femmes avaient l’habitude de marcher plusieurs heures par jour en haute altitude. Ce quotidien très particulier, à l’abri de toute forme de pollution, a conféré à ces montagnards une résistance exceptionnelle. Shimshal et la vallée de la Hunza auraient compté des dizaines de centenaires.
Des scientifiques de toutes disciplines, des ethnologues, des botanistes, des nutritionnistes sont venus les ausculter pour tenter de comprendre les secrets de leur longévité. Leur régime frugal, composé essentiellement de légumes, de céréales, de fruits et de lait, la faible consommation de viande – limitée aux jours de fête –, l’eau chargée en minéraux, l’exercice physique, l’absence de stress et des liens communautaires très forts y ont contribué.
Le village a développé un système de dons collectif, baptisé « nomus », une mise en commun de ressources et de main-d’œuvre pour construire des biens partagés – un chemin, un pont, un canal d’irrigation… – au nom de quelqu’un. Ainsi, au moins, quand les villageois empruntent ou utilisent l’un ou l’autre ces aménagements, ils se remémorent le nom de la personne en question et lui adressent une prière pour élever son âme. Des experts, prudents, ont toutefois émis l’hypothèse que les Shimshalis avaient les traits de centenaires sans en avoir réellement l’âge, en raison de leur exposition au soleil de haute altitude.
A 99 ans, Bibi Nageen semble avoir bien profité du bain de jouvence. En 2020, elle gardait encore ses bêtes sur les hauts pâturages, à la belle saison. Aujourd’hui, ses jambes ne sont plus assez solides et elle n’en a plus la force. « Ça me manque beaucoup, dit-elle. J’aimais cette vie à l’air, même si c’était dur. Nous n’avions aucun luxe. Je portais la même robe jusqu’à l’usure. » La vieille dame, veuve depuis 1980, reste désormais la plupart du temps dans la maison de son fils.
La route de Shimshal a nécessité dix-huit ans de travaux titanesques, entrepris par les Shimshalis eux-mêmes, pour relier le village à la route du Karakoram. Ce raccordement au monde extérieur a bouleversé les habitudes, pour le meilleur et pour le pire. Bien sûr, cette voie d’accès a facilité la circulation des hommes et des biens et généré des sources de revenus. Les familles vendent maintenant leur production agricole, certaines se sont même converties au tourisme en ouvrant des gîtes. Le village, qui a vu naître plusieurs alpinistes réputés, dont Samina Baig, la première Pakistanaise à parvenir au sommet de l’Everest, est prisé des amateurs de treks et des grimpeurs en quête des sommets de plus 7 000 mètres et des glaciers comme le Yazghil ou le Khurdopin.
Régime alimentaire bouleversé
Le confort est entré dans les logis. Rares sont désormais les maisons sans réfrigérateur ni plaques de cuisson. « En 2003, la route n’a pas seulement été un moyen de communication, elle a été synonyme d’une révolution pour notre communauté, raconte Bona Begum, 60 ans, assise sur un tabouret dans la pièce à vivre de sa maison, agencée selon la tradition autour d’un poêle à bois utilisé pour confectionner les pains. D’un coup, nous avons eu accès à la modernité. Les gens ont pu s’acheter des vêtements et des chaussures. Nous avons eu entre les mains des pièces d’argent et nous avons ouvert des comptes en banque. » Bona Begum est attachée à sa terre et ne souhaiterait pour rien au monde en partir, mais elle laisse ses enfants choisir leur vie. Plusieurs d’entre eux ont déjà quitté Shimshal.
Le petit magasin d’Ambreen Karim, 25 ans, témoigne de l’évolution des habitudes alimentaires. Ses étagères sont remplies de bouteilles de soda, de gâteaux, chips, bonbons, savons et détergents industriels, achetés à Ali Abad, le centre administratif et commercial de la vallée de la Hunza. L’échoppe la fait vivre avec sa mère, depuis la mort de son père dans une avalanche au K2 en 2008.
L’ouverture sur l’extérieur a bouleversé le fameux régime alimentaire des Shimshalis, considéré comme le secret de leur longévité. Pour payer les études de leurs enfants, les paysans se sont mis à produire des pommes de terre, au risque de délaisser les céréales indigènes, notamment le blé, indispensable à la préparation des chapatis, le pain qui accompagne tous les repas des Pakistanais. Ils ont réservé la production des abricots à la vente et ils ont commencé à acheter du riz, du blé et autres produits, importés de régions lointaines. Des maladies, telles que le diabète et l’hypertension, ignorées jusqu’alors, ont fait leur apparition.
Progressivement, les Shimshalis se sont éloignés de leur mode de vie nomade. Ils ne migrent plus sur les pâturages du plateau du Pamir, comme ils l’ont fait durant des siècles, et le petit hameau pastoral – où ils dormaient autrefois l’été – est à l’abandon. A la place du kuch, la transhumance collective, neuf bergers se relaient pour garder le troupeau de yaks, et plus personne ne produit de lait ou de fromage. Les bêtes, appréciées pour leur chair dans la vallée de la Hunza, sont uniquement destinées aux boucheries. Leur fourrure et leur peau, utilisées autrefois pour confectionner de beaux tapis et des vêtements chauds, ne sont plus travaillées.
« Traditions encore vivantes »
« Les gens sont devenus paresseux, ils passent leur vie à regarder leur téléphone », déplore Hasil Shah. Cet ancien alpiniste de 58 ans, petite moustache et visage buriné, est rongé par la nostalgie, lui qui a arpenté avec les meilleurs grimpeurs occidentaux les sommets du Pakistan, du majestueux Rakaposhi (7 788 m) au Spantik (7 027 m), en passant par le redouté K2 (8 611 m) et le Nanga Parbat (8 126 m), surnommé la « montagne tueuse ».
L’âge venant, Hasil Shah a rangé ses crampons et ses piolets pour ouvrir une maison d’hôtes. Cela lui rapporte des revenus confortables, mais sans le consoler de la perte des coutumes. « En à peine vingt ans, tout notre environnement a changé, confie-t-il. Le ciment, qui rend les maisons glaciales l’hiver, a remplacé les pierres et la terre. Notre alimentation ne repose plus sur notre production. Maintenant, on fait venir du poulet du Sud. Nous n’en avions jamais mangé avant 2003. On importe du riz du Pendjab, de la farine, bourrés de pesticides. Mes enfants n’aiment pas ma farine ! »
Les deux fils et la fille de Hasil Shah ont étudié dans des grandes universités du pays et la vie ici ne les attire plus. L’un est ingénieur en Allemagne, l’autre est à Karachi, la grande mégalopole du Sud. Sa fille, elle, vit à Rawalpindi, près de la capitale, Islamabad. L’ancien alpiniste ne se fait guère d’illusions : les années du village, dit-il, sont comptées. « Nos traditions sont encore vivantes, mais qui va apprendre de moi ? Mes enfants sont partis, ils font de l’argent. Ils ne reviendront pas. »
Mohamed Amin, le professeur à la retraite, porte, en ce matin du 25 mai, un shalwar kameez, la tenue traditionnelle des hommes pakistanais, une tunique à col Mao et pantalon assorti. Il s’est coiffé d’un béret en laine blanc, symbole de cette région. Toute la communauté s’est rassemblée devant l’école, dans l’attente de l’hélicoptère qui doit transporter un visiteur de marque : le représentant de l’Aga Khan. Comme 84 % de la population de la vallée de la Hunza, les habitants de Shimshal sont des ismaéliens nizârites, un courant issu de l’islam chiite, libéral, représenté par l’Aga Khan, qui compte dans le monde entre 12 millions et 15 millions de fidèles. L’Aga Khan IV, mort en février et remplacé par son fils, avait financé pour moitié la route de Shimshal ; le reste a été pris en charge par le gouvernement. « Il a œuvré dans toute la Hunza », se félicite Anwar Baig, guide et traducteur de la langue wakhi.
A travers ses organisations philanthropiques, le leader des ismaéliens a fait de la vallée de la Hunza et de tout le Gilgit-Baltistan la région la plus éduquée du Pakistan, avec un taux d’alphabétisation de 97 %, contre 60,7 % à l’échelle nationale. Dès les années 1960, il a ouvert des écoles dans presque chaque village, contribué à la construction d’hôpitaux, de ponts et de canaux d’irrigation, fait installer l’eau courante et des systèmes d’assainissement.
L’évolution de la vallée préfigure sans doute l’avenir de Shimshal, le dernier village raccordé à la Karakoram Highway, l’épine dorsale de l’économie. Située sur l’ancienne Route de la soie, cette région de haute altitude est restée isolée durant des millénaires. Les aventuriers occidentaux de passage dans les parages au début du XXe siècle ont abondamment relayé l’image d’un paradis terrestre, répétant que le romancier britannique James Hilton avait situé ici la Shangri La, vallée mystique et harmonieuse décrite dans son livre Les Horizons perdus (Les Belles Lettres, 1933). « Nous étions des nomades élevant nos chèvres, nous ne connaissions rien du monde extérieur, nous ignorions les guerres qui se jouaient ici et là. Nous savions juste qu’il était difficile de trouver du sel », explique d’une voix fluette Naina (son nom de famille n’a pas été communiqué), une centenaire installée à Karimabad, 16 000 habitants, la « capitale » de la Hunza, avec ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.
La région, royaume dirigé par un mir (« prince ») jusqu’à son intégration dans le Pakistan en 1974, s’est ouverte au monde en 1980, avec vingt ans d’avance sur Shimshal, lorsque les Chinois ont achevé la Karakoram Highway, 1 300 kilomètres entre le Xinjiang et la mer d’Oman. « Jusqu’à l’arrivée de cette route, la majorité de la population de la Hunza était très pauvre, résume Babar Khan, responsable régional du Centre international pour le développement intégré des montagnes et natif de la vallée de la Hunza. Les paysans cultivaient leurs champs pour la petite agriculture de subsistance, qui dépendait entièrement de la fonte des glaciers. Il n’y avait aucun marché pour vendre les éventuels surplus et gagner de l’argent. »
Le développement a été rapide, marqué par le déclin de l’agriculture de subsistance, l’expansion de l’économie monétaire et l’essor du tourisme. La région, avec ses paysages majestueux, ses hommes et femmes aux traits européens, réputés pour leur tolérance et leur hospitalité, constitue une destination majeure pour les habitants des plaines.
Mais la fin de l’isolement a eu l’effet d’un boomerang. Le peuple de la Hunza, autonome et suffisant, a compris brutalement, en 2022, qu’il dépendait désormais entièrement de l’extérieur. Le 7 mai de cette année-là, après un épisode de hausse soudaine des températures dans le nord du Pakistan, un lac sous le glacier Shishper a rompu, générant un flot monstrueux d’eau et de roches qui dévala les pentes, dévastant tout sur son passage : un GLOF (inondation par débordement d’un lac glaciaire), dans le jargon des glaciologues. Dans le seul village de Hassanabad, vingt-quatre maisons, des terres cultivées et deux petites centrales électriques furent avalées, ainsi que le pont reliant le bourg au reste de la Hunza. L’ouvrage, construit en 1972, constituait un lien vital entre le nord du Pakistan et le reste du pays. Le commerce avec la Chine en dépend, la Hunza étant la porte d’entrée du corridor économique Chine-Pakistan.
Durant plus de sept mois, la vallée fut coupée de tout. Les habitants, démunis, ne savaient plus faire seuls. « Cela a eu un impact énorme sur la vie locale, témoigne Babar Khan. Toute la chaîne d’approvisionnement a été rompue. Les gens n’étaient pas préparés à une catastrophe d’une telle ampleur. L’argent qu’ils avaient acquis avec l’ouverture de la Karakoram Highway n’était d’aucune utilité. Ils avaient arrêté de cultiver du blé. Ils n’étaient plus autosuffisants. Avant, chaque foyer avait un grenier sur son toit où il gardait les fruits et tout le reste pour les rudes hivers. Toutes ces habitudes se sont perdues. »
Erosion des berges de la rivière
Ce désastre, dont Hassanabad ne s’est pas encore remis, a rappelé les habitants à la réalité du changement climatique. La « vallée des immortels », ainsi surnommée en référence à ses centenaires, vit sous la menace de ses géants blancs qui ont fait sa renommée : le glacier Batura (57 kilomètres), ou encore le Mochowar et le Shishper. Ainsi cernée, la vallée de la Hunza est considérée comme la plus vulnérable de la chaîne du Karakoram aux risques de GLOF.
Depuis une dizaine d’années, les calamités s’enchaînent dans les environs. En janvier 2010, un énorme glissement de terrain a bloqué la rivière éponyme à hauteur du village d’Attabad, créant un lac artificiel de toute beauté, mais perturbant la vie de 6 000 personnes dont les maisons, les vergers et les fermes furent engloutis. De larges portions de la Karakoram Highway ont été submergées, perturbant gravement la communication entre les hameaux. Durant quatre ans, hommes et marchandises ont dû être chargés sur des barges pour traverser le lac. Ce n’est qu’en 2015 que les communautés locales en amont ont pu retrouver une vie normale, avec la mise en service d’une route alternative de 22 kilomètres qui passe sous six tunnels financés par la Chine.
Au pied des cônes du Karakoram, le village de Passu a déjà perdu plus de la moitié de sa population et de sa superficie après des épisodes d’inondations. L’érosion des berges de la rivière, due à la fonte des glaciers, a détruit des dizaines de maisons. Mohamed Hassnat, 91 ans, ancien conducteur de camions dans l’armée, compte parmi les déplacés. Sa famille a déménagé trois fois. A l’époque de son père, le village était situé sur l’autre rive de la rivière Hunza. Il a été détruit par une gigantesque inondation consécutive à un débordement d’un lac glaciaire. La famille a construit une nouvelle maison sur la rive opposée, mais celle-ci a été avalée par la rivière. Pour sécuriser le village, des murs en pierre ont été élevés le long des berges.
Il espère que sa nouvelle demeure et le verger attenant seront suffisamment éloignés de la Hunza. « La hausse des températures est un désastre dans notre région, témoigne son fils, Amjed Karim, 53 ans, guide pour une agence de voyages. Nous n’avons presque plus de neige l’hiver, essentielle pour l’irrigation, car nous n’avons pas de mousson et les étés sont torrides. » Dans les vergers, la hausse des températures fait proliférer les parasites et les insectes. Dans les champs alentour, elle perturbe la période des semis.
Malheureusement, les scénarios des climatologues laissent présager bien d’autres catastrophes. La température moyenne dans le nord du Pakistan augmente plus vite que dans le reste du territoire et pourrait s’élever de 4,8 °C d’ici à la fin du XXIe siècle. La perspective est cruelle pour ce pays de 247 millions d’habitants, très faible émetteur de gaz à effet de serre (à peine 1 % des émissions mondiales), mais l’un des plus vulnérables au réchauffement climatique et aux phénomènes météorologiques extrêmes, avec ses 13 000 glaciers. A Shimshal, l’ancien alpiniste Hasil Shah a vu de ses yeux les masses de glace reculer d’année en année, annonçant, selon lui, le triste crépuscule de la « vallée des immortels ».
[Source: Le Monde]