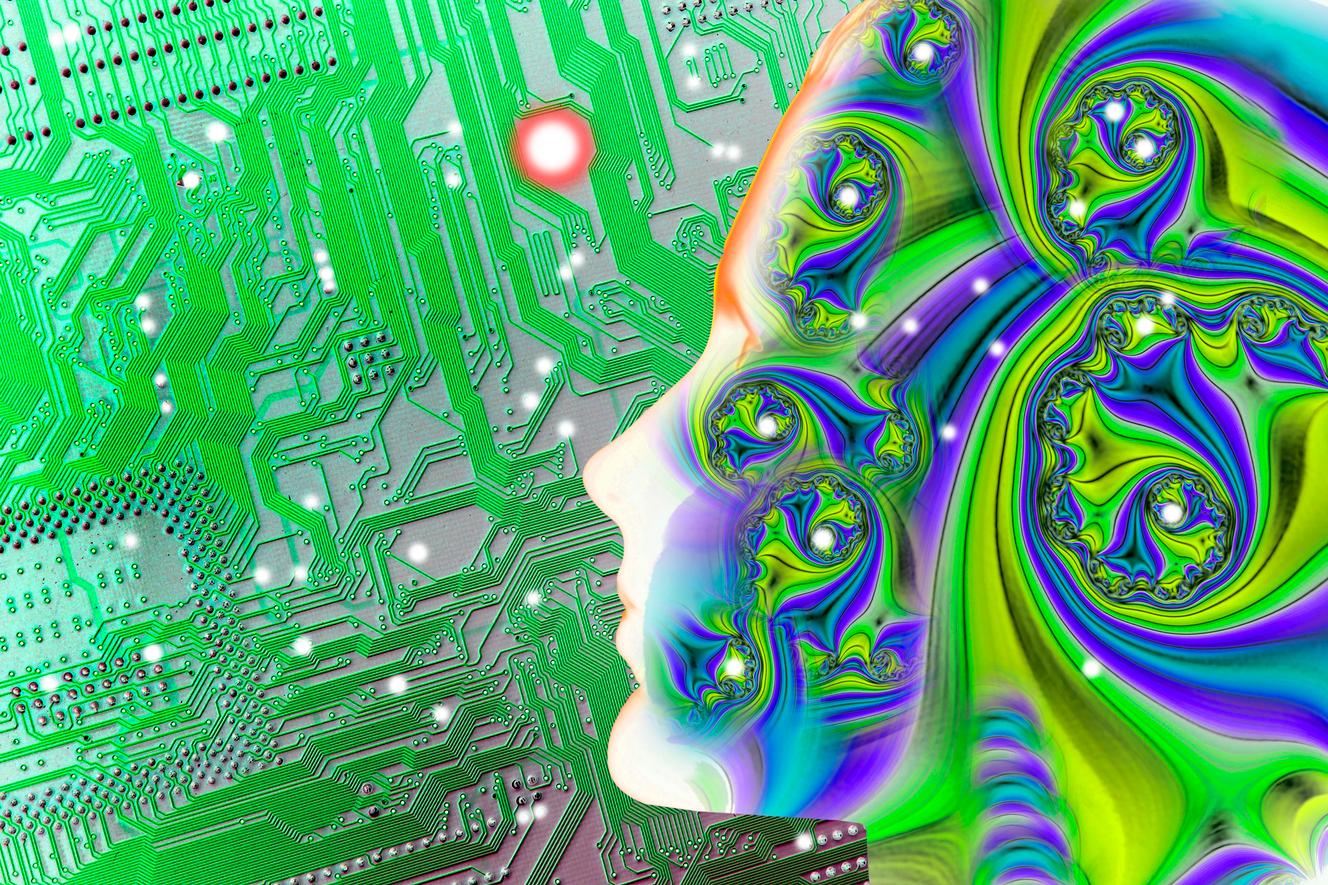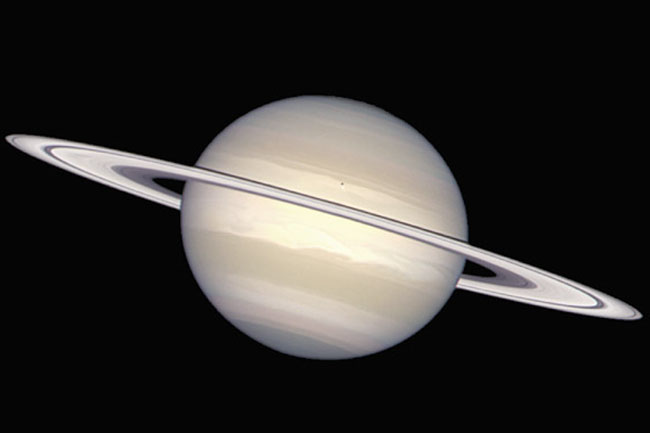Loin de La Havane, une traversée de Cuba, sous l’œil inquisiteur de la sécurité d’Etat
Cette nation dont la population, épiée en permanence, a appris à vivre entre débrouille et marché noir.

Sur le mur du local technique, au pied d’un immeuble de La Havane donnant sur la mer, une main tremblante, qu’on imagine inquiète et pressée, a inscrit à la bombe de peinture l’un des rares signes de contestation observables dans tout Cuba. Le ou la contestataire a choisi un subterfuge, comme pour se protéger au moment de passer à l’acte, dessinant les deux idéogrammes chinois du mot « liberté », tels que les manifestants prodémocratie de Hongkong le clamaient et l’écrivaient pour résister à l’emprise de la Chine. La référence a échappé aux censeurs cubains. Les yeux de la sécurité, qui sont partout, n’ont pas capté le message. En deux semaines d’itinérance dans l’île, on n’en a pas vu beaucoup d’autres aussi clairs quant à leur intention.

Par relation de cause à effet, la surveillance des agents divers, plus ou moins discrets, mais veillant au grain partout, entravant dès qu’ils le pouvaient toute forme d’échange avec les Cubains, est une constante absolue de la vie dans le pays. Alors, en sortant de la capitale, sur la route qui longe la côte, ce « liberté » sonne étrangement, comme un cri étranglé. Au cours de nombreuses rencontres, tant de personnes auront avoué leur peur de parler en public, voire de parler tout court, même pour d’honnêtes et raisonnées critiques du Parti communiste, en ces temps d’effondrement national.
De La Havane, nous sommes partis, à vélo, à la découverte de l’état de cette nation en train de traverser une crise économique d’ampleur historique, et dont un quart de la population a fui volontairement en moins de cinq ans, tandis que pèse, comme un grizzli assis sur son cou, tout le poids du géant américain qui ne lui veut pas de bien.
Pourquoi le vélo ? Pour aller doucement, pour aller partout, réaliser des boucles à l’intérieur du pays et s’écarter des lieux assignés aux touristes, avec tout le fatras de ce qui est devenu une denrée d’exportation, le pittoresque cubain (cigares, salsa, décapotables américaines, Che Guevara). Voir Cuba de l’intérieur, dans tous les sens du terme.
Rouler à vélo, c’est se mettre aussi à la bonne vitesse. « Voyager lentement, c’est rencontrer vite », comme le formule le cycliste suisse Claude Marthaler, dans Confidences cubaines, (Transboréal, 2015). Personne ne va vite sur les chemins, ni sur les routes, Cuba n’a plus les moyens pour cela. Sur les grands axes, à la sortie de La Havane, on peut faire la course avec des scooters électriques, qui ont remplacé les modèles à essence, et des collectivos, de vieilles guimbardes qui font office de taxis collectifs et crachent des nuages de fumée noire. On se retrouve aux feux. Puis on s’élance…
Quelques heures plus tard, la campagne défile. Routes presque désertes, chevaux, carrioles, triporteurs. Soleil, aussi. Il va falloir trouver de l’eau. La chercher, c’est autant de chances d’entamer une conversation. Les trois hommes, assis à l’ombre devant la petite Mipyme (épicerie) plantée à un carrefour au milieu de rien, ne sont pas d’un abord commode. Voir débarquer deux cyclistes, suants, soufflants, étrangers de surcroît, ne leur inspire pas de sympathie immédiate. Tout de même, la curiosité est la plus forte. Ils sont surpris d’apprendre que nous roulons inconsidérément aux heures les plus chaudes, en direction d’une zone située encore à une bonne centaine de kilomètres (que nous n’atteindrons pas).

« Et sinon, d’après toi, quels sont les trois acquis principaux de la révolution ? », me demande l’un d’entre eux, présenté par ses camarades comme « le Chaviste » (soutien d’Hugo Chavez, ex-président vénézuélien, allié du pouvoir de La Havane). Ce n’est pas une plaisanterie. Je me lance : « La santé, l’éducation et la dignité retrouvée du peuple cubain. » Il sourit, on dirait que ma réponse tient à peu près la route doctrinaire chavisto-castriste, et la glace est rompue. Ce sont eux qui nous recommandent avec enthousiasme d’emprunter l’autoroute pour aller plus vite, s’amusent de nos hésitations à ce sujet, mais s’inquiètent aussi de la chaleur. C’est un coup à se déshydrater, toute cette route qui nous reste, estiment-ils en sifflant du rhum à petites gorgées.
Plus tard, on se retrouve sur la carretera (route principale) « panaméricaine ». Son asphalte ressemble à la carapace d’un tatou, fragmenté en myriades de morceaux qui craquellent sous les roues. Il n’y a presque personne, parfois un médecin, pouce levé, qui montre une blouse blanche sortant d’un sac, pour être pris en stop. Mais les véhicules sont rares. A l’inverse, les installations militaires paraissent innombrables. Certaines sont des camps, dûment identifiés. D’autres sont indiscernables, en raison d’un talus couvert d’herbes folles qui obscurcit la vue depuis la route. On ne sait ce qui se cache derrière, installations secrètes ou fermes.

A un embranchement, une corde est tendue en travers de la route. Nous allons la passer quand un homme s’approche, à allure réduite, sur une petite moto (il a donc accès à de l’essence). Il en descend posément et nous demande si nous avons l’intention de pénétrer dans cette zone militaire interdite. Comment a-t-il pu nous voir approcher ? Guettait-il, embusqué dans les buissons ? Impression fulgurante d’un univers où le contrôle a toujours un coup d’œil d’avance.
On voit la mer, elle est belle, mais vide, étrangement vide. Pas un bateau de pêcheur à l’horizon : c’est interdit, car les droits de pêche sont contrôlés et monnayés par des gens tout là-haut, dans l’échelle sociale de la société s’affirmant égalitaire. Et quand un Cubain veut parler de ces êtres, il fait un geste de deux doigts réunis frappant son épaule, et cela signifie : des galonnés. L’eau de l’étendue marine est d’un bleu qui rendrait lyrique, mais il est évident que l’espace le long de la côte est confisqué par des gens en uniforme, voire en civil, mais liés tout autant au domaine de la sécurité, l’un des multiples axes de la défense de l’île, nimbée dans ce qu’on pourrait qualifier de paranoïa justifiée, fruit de décennies de préparatifs dans l’hypothèse d’une tentative d’attaque téléguidée par les Etats-Unis. Cette hypothèse, bien réelle pendant la guerre froide, avait fini par être remisée au placard de l’histoire. Le retour de la volonté américaine, proclamée haut et fort, d’être l’outil de la chute du pouvoir cubain, par un moyen ou un autre, a ressuscité le monstre.


On roule dans la paisible et morne campagne, les kilomètres filent quand, tout à coup, s’ouvre sur la route le spectacle d’un vaste combinat industriel. Cheminées fumantes, bâtiments couleur terre. Un bruit sourd émane d’une des usines, la cimenterie René-Arcay (organisateur syndicaliste héroïque, mort dans l’explosion d’une bombe qu’il était en train de fabriquer), encore en activité. On dirait un très gros animal en train de geindre avant de mourir. Voilà Mariel, avec son port. Un petit détour par la baie avec vue sur les quais, contrôlés par le consortium de l’armée, Gaesa, et où se trouve le plus grand terminal de conteneurs du pays. On y décharge des marchandises, et une chose rare dans le pays : des voitures neuves, plus précisément des Dongfeng Aeolus chinoises. Dans le petit café-Mipyme au bord de l’eau, on demande s’il est possible de prendre une des glaces qui figurent au menu. C’est possible, mais il faut acheter un bac d’un demi-litre, seul conditionnement disponible. On repart, songeurs, méditant sur les folies d’une économie déréglée où le trop peu génère parfois le trop, du moins pour une minorité.
Les routes se suivent, puis commence l’autoroute tant vantée par les amis du « Chaviste ». Quelques cars, des camions qui nous frôlent sans ménagement, notamment des portes-voitures chargés des mêmes Aeolus vues à Mariel, et qui semblent en train de déferler sur le marché. On croise des cyclistes qui s’entraînent sur la même portion d’asphalte au milieu des poids lourds, preuve qu’il n’est pas déraisonnable de ne pas suivre à la lettre le code de la route. A la bonne heure ! Le samedi, les amateurs de vélo y organisent même des courses, sans interruption du trafic. Ailleurs, ce sont les conducteurs de moto ou les propriétaires de Lada, modèle vintage soviétique, qui se tirent la bourre en zigzaguant quand c’est nécessaire. De temps en temps, il y a de terribles accidents, qui n’arrêtent pas les adeptes de la fureur de vivre, dans un pays où les distractions sont rares. A la sortie, à Guanajay, des gosses nous accompagnent sur leurs propres vélos, l’un en wheeling savant (roue arrière). Ils disent qu’ils ont parcouru vingt kilomètres aujourd’hui. « Et vous ? » « Cela fera environ 90. »
Un petit monde secret
A la tombée du jour, nous atteignons Artemisa. A l’entrée de la ville, sur fond de crépuscule grandiose, défile la série impressionnante de dix-sept cubes suspendus géants, sur lesquels figurent les portraits de héros locaux, les « martyrs » de la ville tombés sur le chemin de la libération de Cuba, lors de l’événement inaugural qui lança l’épopée révolutionnaire, l’attaque de la caserne de Moncada par le groupe formé par Fidel Castro, en 1953.
La nuit est tombée. Rouler à vélo dans l’obscurité n’est pas interdit, mais tout à fait idiot. Il faut trouver un point de chute. L’hôtel prometteur, présenté comme ouvert sur les réseaux sociaux, s’avère plus que fermé : son toit s’est écroulé. Une femme du voisinage indique que, non loin, quelqu’un loue peut-être des chambres. Allons voir ça.

Effectivement, dans son jardin, un certain Victor (dont le prénom a été changé) a construit de ses mains tout un petit monde secret. A l’arrière de sa maison, deux chambres avec douche, ventilateur et minibar garni de cinq bières donnent sur une cour décorée de quelques meubles, et d’une minipiscine en béton, vide, mais peinte en bleu. Sa clientèle habituelle, d’un genre particulier, est composée de couples qui réservent pour deux heures afin de jouir d’une intimité discrète, boivent peut-être les cinq bières, puis s’en vont. Certains habitués, de l’avis du propriétaire, reviennent quasiment tous les jours. Il fait nuit noire quand nous pénétrons dans le jardin. Justement, un couple descend d’une Jeep. L’homme et la femme mettent la main devant leurs yeux pour cacher leur visage de la lumière de nos lampes frontales, tandis qu’ils se glissent dans la chambre pour les deux heures de rigueur. Ensuite, l’espace est libre.
Victor se révèle être un homme pratique et sensible, du genre à s’interrompre dans le ménage des chambres pour vous appeler à grands cris afin de vous montrer un nid de colibri sur une branche de manguier. Il sait aussi comment naviguer à travers son monde à la barre d’une activité qu’il définit avec force mots et force gestes, se situant « sur la très mince frontière entre légalité et illégalité ». Là, il mime l’eau qui coule dans la rivière, en faisant aussi les ondulations des vagues. Cela indique, en substance, qu’il faut savoir à la fois onduler et suivre le courant pour ne pas se fracasser sur les rochers.
On peut donc agir ainsi à Cuba, échapper aux radars, tenir une maison de rendez-vous sans que cela finisse mal ? Normalement, un hôte doit être répertorié et faire un rapport à la police s’il accueille des étrangers. Pas lui. Encore le geste de la main faisant les vagues de la rivière : « Il y a le Cuba qu’on montre aux touristes et le vrai Cuba. Et le vrai Cuba fonctionne avec le marché noir, voyons ! »


Plein d’entrain, il montre les photos de sa fille unique, partie au Japon il y a deux ans. Peu de temps auparavant, elle lui avait dit un soir : « Papa, regarde ma photo de classe. Je suis la dernière, tout le monde a quitté le pays. Si je reste ici, je ne connaîtrai plus personne. » Le cœur serré, il l’a laissé rejoindre un cirque à Tokyo, où elle exécute un numéro de danse cubaine, visite des temples qu’il contemple rêveusement, avant de passer à ses propres clichés de vacances, sur lesquels on le voit chevaucher deux dauphins (un sous chaque pied) ou visiter un hôtel géant à Varadero, les plages du nord de l’île dévolues au tourisme de masse, actuellement en grande partie désertées. Puis il parle de sa fille, avec émotion. Il est inenvisageable qu’elle revienne pour des vacances, compte tenu du prix du billet d’avion. Elle vient de resigner pour deux ans avec son cirque japonais. Ils ne savent pas quand ils se reverront.
L’état du pays le met en rogne, pas mal, tout le temps. Victor appartient à la famille des entrepreneurs bouillonnants, même s’il reste flou sur l’ensemble de ses entreprises, diverses et variées. Cela l’a conduit à identifier ce qui constitue, selon lui, l’un des maux principaux de la société cubaine : les gens qui n’en fichent pas une. « Vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes dans les administrations qui ont des emplois imaginaires, passent leur vie à ne rien faire et se plaignent du gouvernement. Ils ne veulent pas changer le système, c’est ça aussi Cuba ! Ils aiment mieux grossir que changer ! » Lui s’entretient sérieusement. Ventre plat, bras noueux, Monsieur 100 000 volts. Justement, il consulte sa montre-bracelet d’un geste vif : 9 heures du matin, et il y a encore de l’électricité ! Il se demande quand ça va couper aujourd’hui. « Si par hasard [Nicolas] Maduro est libéré, on va avoir de l’électricité à gogo, ça va être la fête chez nos dirigeants. » Et il rit de sa bonne blague.

Le sort de l’ex-président vénézuélien enlevé par une opération commando américaine dans la nuit du 2 au 3 janvier lui est, il l’avoue, totalement indifférent. Il a beau avoir la cinquantaine, dans une classe d’âge habituellement fidèle à la « révolution » et à ses idées anti-impérialistes, il ne nourrit pas d’animosité particulière envers les Etats-Unis. « Au contraire, qu’ils viennent, les Américains, qu’ils viennent ! On va le développer ensemble, ce pays ! », dit-il sur le même ton enjoué. Puis, se ravisant : « Malheureusement, on risque de les attendre longtemps ! On n’a pas de mines, pas de ressources, rien qui puisse les intéresser. Ce n’est pas notre sucre qui va les faire venir, étant donné qu’“ils” [le pouvoir cubain] ont complètement tué ce secteur. Le seul sucre cubain qui nous reste, c’est dans les chansons de Celia Cruz. »
Vastes friches
Il faut bien se quitter. On rayonne ensuite dans la campagne, en longues étapes sur les plus petites des routes, à travers des hameaux, des chemins. Au milieu des champs, dont certains, envahis de broussailles ou de buissons de marabou, ne sont que de vastes friches, on distingue les structures décharnées d’usines, d’immeubles d’habitation, de hangars, tous en ruine, les couleurs de leurs murs avalées par le temps et les pluies. Un grand cimetière d’éléphants, celui de l’économie cubaine centralisée, se cache dans ces campagnes désolées, dont les travailleurs se sont, pour la plupart, enfuis vers les villes. On y croise quelques vieillards, des enfants de familles très pauvres. Il y a tant de maisons fermées, aux volets clos. On dirait qu’une épidémie mystérieuse a frappé les lieux.
A Puerta De La Guira, minuscule village à la croisée des routes, quelques jeunes sont en train de descendre des bières assis à une sorte de terrasse couverte. Arrive un gars sur un scooter, avec, serré entre les jambes, un gros baffle qui émet des torrents de reggaeton et des éclairs de lumière colorée. On dansotte aux tables, les voisins s’y mettent aussi. Une femme et sa fille entament un pas compliqué et gracieux. Deux devantures sont ouvertes sur la rue : celle de la Mipyme, qui vend les bières, et une autre, la bodega, épicerie officielle et lieu de distribution des produits subventionnés. Une femme est derrière le comptoir, immobile comme une statue coupée au niveau du nombril. A la question simple : « Qu’avez-vous à vendre en ce moment ? », réponse simple : « Absolument rien. » Au moins profite-t-elle de la musique.

Victor l’avait dit : « L’autre problème [de Cuba], c’est qu’il y a des militaires partout, tout leur appartient. » Mais s’il est un corps de métier qui brille par son ardeur à la tâche, c’est bien celui des agents de la sécurité, dont la raison d’être est de surveiller et de punir la population, pour parer à toute forme de contestation comme par habitude ou, peut-être, par penchant personnel. A Artemisa, en fin d’après-midi, alors que nous traversons une série de HLM déglingués, une Lada bleu gendarme, avec des antennes à l’arrière comme au temps des radiotéléphones, freine et nous coince au coin d’une rue. La sécurité nous a repérés.
De quoi sommes-nous coupables ? L’heure n’est pas aux discussions, l’homme nous intime, simplement, l’ordre de quitter la ville sur-le-champ, « parce que les touristes étrangers n’ont pas le droit de coucher là », faute d’endroit homologué à cet effet. Il ignore l’existence de Victor, de toute évidence. Il est intraitable. Dehors, les étrangers ! Il nous suit un moment, puis certains de ses collègues prennent le relais. Nous leur échappons après le crépuscule en roulant tous feux éteints à la faveur de l’obscurité. Allez donc pister deux vélos dans la nuit quand tout l’éclairage public est mort !
Dans cette longue pérégrination, surviennent aussi des rencontres qui valent le voyage à elles seules. Ainsi, dans cette maison verte, au milieu de la campagne, dans l’ouest. A l’intérieur, Marianna et Marianne, des jumelles qui sont nées et ont grandi ici, dans cette demeure presque vide où passent les courants d’air, seule climatisation. Comment s’organise une vie tranquille, quand il y a peu ? D’abord, compter sur le jardin, ses légumes, ses fruits. Marianna, qui tient une minuscule boutique au coin du grillage, où elle vend aussi du café, vous tend une orange verte, pour le plaisir d’en sentir le parfum, puis va cueillir une goyave, pour le Hutia dans sa cage. Son frère passe, en bottes de plastique, affairé aux travaux agricoles. Sa femme, cigarette au bec, déboule sur un scooter électrique. Quand paraît Sara Bianco, la grand-mère, 81 ans. Toute une vie à travailler dans les fermes des environs pour de tout petits salaires. Une forme exceptionnelle, une gaîté irrésistible.
Elle n’a pas de retraite, mais une famille, et tout le monde contribue pour que la vie soit vivable. Les jumelles tiennent la petite boutique, l’une fait les ongles des voisines. La famille possédait un champ de café. Il a fallu le vendre pour financer le passage du fils de Sara (le père des jumelles) vers l’étranger. Dans la région, on part sur de petites barcasses du rivage de Playa Majana, au sud, et on tâche de ne pas couler avant d’arriver au Mexique. Puis, direction les Etats-Unis. La Floride. Il y conduit des camions pour envoyer, comme tant d’autres, de quoi vivre à ceux restés à Cuba. Le jour où il aura un peu économisé, dit sa mère, « il reviendra ici ouvrir une pizzeria ». Il ne faut pas imaginer des folies, avec un pizzaïolo, un four napolitain et des câpres. La pizza, à Cuba, a sa version spéciale, faite dans les endroits simples d’un rond de pâte à pain de la taille d’une assiette à dessert, de fromage, et puis c’est tout. Cela gagne à être cuit, puisque, de toute manière, il n’y a jamais d’électricité, sur un petit brasero au charbon, qui fait gratiner le fromage et donne un goût délicieux. On en trouve dans les petits villages, au hasard des chemins : une gourmandise modeste et une activité tout aussi modeste, mais sûre. Sara Bianco a hâte de le voir rentrer, son courageux camionneur de fils.
Ses autres enfants sont dispersés en Europe. « Moi, ça ne m’intéresse pas du tout de m’en aller aux Etats-Unis, ou ailleurs », affirme-t-elle. Avant tout, elle se déclare « fille de la révolution ». Ses petites-filles lèvent les yeux au ciel. La voilà qui recommence. Sans se démonter, leur grand-mère va chercher son poste de radio à piles, l’allume, met Radio Cuba, esquisse quelques pas de danse tout en expliquant ce que l’arrivée au pouvoir de Fidel Castro a signifié, dans son cas, « la libération », au sens fort du terme. Elle avait alors 15 ans… « Je suis issue de la minorité des “Indiens”, on était des moins que rien avant la révolution », dit-elle. Toutefois, elle l’avoue bien vite : sa priorité, ces temps-ci, est avant tout la recherche d’un nouveau compagnon masculin.

Ses petites-filles l’ont mise sur des réseaux sociaux, elle fait déjà des touches sur Instagram. Avec sa dernière conquête, elle était allée à Varadero, au bord de la mer, et avait forcément emmené toute la famille. « C’était bien, mais la nourriture était horrible. » Dans la cuisine, il n’y a presque rien, hormis un congélateur, l’objet essentiel de l’économie domestique cubaine, pour stocker ce qui ne peut être conservé autrement. Il est en berne, forcément. Pour les plats, dans la maison verte, on cuit force manioc et patates douces. Peut-être est-ce là une des raisons de la forme insolente de Sara Bianco ?
Les heures passent, on boit de petites tasses de café. Deux chiens s’étirent sur l’herbe. On regarde les photos de la famille : les jumelles qui grandissent, les mariages, les sorties. Tant de bonheur éclatant, renforcé par les rires qui fusent. « Ici, c’est bien, il fait beau, c’est la Caraïbe, mais honnêtement, je m’en fous de Cuba, dit Marianne. Pourtant, je ne veux pas m’en aller pour une raison : on est trop bien ensemble, dans notre famille. »
Industrie sucrière décimée
Etape suivante : Abraham Lincoln. Nous étions curieux de savoir à quoi cela pouvait ressembler, une petite ville nommée de la sorte. Elle est perdue dans la campagne, au sens dramatique du terme. A la recherche de quelque chose à se mettre sous la dent, on ne trouvait pas l’ombre d’une pizza cubaine. A défaut de quoi, nous tombons sur la plus microscopique des épiceries, organisée par une femme sur son rebord de fenêtre, derrière la clôture grillagée entourant le jardinet, devant chez elle. La transaction se déroule en passant au-dessus du grillage, comme si le vol à la tire était courant, surtout chez les cyclistes. Un paquet de six biscuits, deux bonbons. Il n’y avait pas de second paquet de biscuits en stock.
Le nom d’Abraham Lincoln avait été choisi par le propriétaire de l’usine sucrière qui était la raison d’être du village. Celle-ci a fermé en 2009. Il reste des machines rouillées, des bouts de choses indistinctes éparpillées. Des bâtiments s’effondrent par pans. La végétation, elle, prend doucement sa revanche et foisonne à qui mieux mieux.


Il y a, dans le paysage, de multiples champs de cannes à sucre, cette canne si emblématique de Cuba. Mais pour trouver le cœur de la région sucrière, il faut se déplacer vers le centre de l’île. Là, dans un champ, on voit justement commencer la zafra, la récolte. Un engin manœuvre au milieu de rangs de cannes, et déverse un hachis de tiges dans la benne d’un tracteur. La moissonneuse a tellement été réparée, soudée, bricolée, qu’il devient difficile de voir si elle appartient au parc des machines spéciales conçues sous la supervision de Che Guevara, puis fabriquées par une ligne de production à Santa Clara, plus au nord. Ces libertadoras (libératrices), comme les machines avaient été appelées, devaient augmenter la productivité, mais aussi libérer les coupeurs de canne équipés de machettes de leur tâche harassante. Mais, dans ce champ, les ouvriers qui regardent hoqueter l’engin ont le moral dans les bottes en plastique : « Il n’y a plus d’intrants [engrais, produits phytosanitaires] », explique l’un. Et tout est devenu compliqué à chaque étape de la production. Plus d’essence pour les camions, plus de pièces de rechange, etc.
Il y avait 133 usines sucrières à Cuba, à la grande époque, au début du XXe siècle. Jusqu’en 1989, le pays était le premier producteur mondial de sucre. En 1970, Fidel Castro avait même tenté de hisser la production lors de la campagne à 10 millions de tonnes. Ce fut raté, mais de peu. En 2025, cette production n’a atteint que 140 000 tonnes (près de 70 fois moins). Il reste aujourd’hui quatorze usines, dont seulement six fonctionnent. La récolte 2026 s’annonce comme la pire du XXIe siècle. Et les conséquences se ressentent à travers toute une nation qui avait coutume de dire « sin azucar, no hay pais » (sans sucre, il n’y a pas de pays), affectant, par exemple, la production d’alcool médical, et, peut-être tout bientôt, celle de rhum, l’un des derniers secteurs de l’économie toujours vivace.

A Santa Clara, Che Guevara est plus qu’un monument national ou un concepteur de moissonneuses à canne. C’est là que sa dépouille, ramenée de Bolivie en 1997, trente ans après sa mort, ainsi que celles de ses compagnons de combat, repose dans un mémorial net, vaste et beau. C’est aussi à Santa Clara que, fin décembre 1958, le Che avait à la fois pris la ville considérée comme le verrou de La Havane, et fait dérailler puis neutralisé tout un train blindé de l’armée lancé à la rencontre des rebelles pour les stopper. Le régime de Fulgencio Batista était tombé dans les jours suivants et les « barbudos » avaient pris le pouvoir.
Depuis, le révolutionnaire argentin est devenu l’un des principaux pôles d’attraction des touristes du monde entier. Au Mémorial Che Guevara, à la sortie de la ville, on a prévu un parking colossal pour les bus. Les rares véhicules dont descendent les quelques touristes en visite pour leur excursion du jour rendent l’espace encore plus vide. Tout de même, un Cubain à vélo arrive, et va dignement poser un bouquet de fleurs à la mémoire des héros d’un monde enfui. En ville, dans les ruelles réputées pour leur charme, des portes entrouvertes laissent bouche bée. Dans les montées d’escalier, les habitants tentent de vendre des babioles, si pauvres. La ville crie famine. Même les terrasses des bars d’hôtel, sur la place Leoncio-Vidal, au centre, qui était ségréguée au XIXe siècle (un trottoir pour les Blancs, un autre pour les Noirs), sont vides.


Eduan, lui, n’a cure de tout cela. Il ne demande qu’une chose : que les touristes reviennent en masse. Leur nombre, qui atteignait quatre millions de visiteurs, est en chute libre (1,7 million en 2025). Les hôtels sont vides, les casas particulares (maisons d’hôtes officielles) ferment, pour beaucoup, les guides sont au chômage.
Eduan est l’une des victimes de ce marasme. Il était maître-nageur sur la plage près de Varadero, et entraîneur dans les salles de sport. Comme il adorait cette vie au bord de la mer, malgré l’irruption croissante de touristes russes qui, à l’en croire, lui ont donné bien des tracas. « Ils sont spéciaux, très spéciaux. Quand on met le drapeau rouge pour dire que la baignade est dangereuse, ils s’en foutent. Ils t’engueulent et te bousculent pour aller dans l’eau », raconte-t-il en guidant des garçons de Santa Clara venus travailler leurs adducteurs sur les appareils. Il n’attend qu’une chose : retourner à la plage, reprendre sa vie. Impossible de dire si cela arrivera un jour.
Au sud de Santa Clara, certains chemins sont si abîmés qu’ils sont devenus impraticables aux véhicules. Dans la boue et les ornières, on distingue des traces de sabots ou de bottes en plastique. Les rares maisons semblent dénuées de tout. Des chiens squelettiques jappent. Même les poules se font rares. Dans les villages, les agents de la sécurité n’en sont pas moins là, mêlés à la population au regard distant, évitant le contact, prêts à vous chasser comme des mouches. « De quel pays êtes-vous ? Où allez-vous ? », demandent-ils, vous collant au train jusqu’à ce que, de guerre lasse, on remonte en selle pour aller voir plus loin s’ils y sont.
Surveillance maniaque
Encore une ville écrasée de silence dans l’après-midi : San Fernando de Camarones. Ses bâtiments, qui ont été beaux, ont dû coûter à leurs propriétaires des sommes folles, à une époque où les prix du sucre, au début du XXe siècle, flambaient. Avant de chuter. Avant que tout, ensuite, se délite. Dans la grand-rue, où les cailloux affleurent sous l’asphalte presque blanc à force d’être délavé, quelques hommes discutent de façon animée. Une pause s’impose. C’est samedi, et un petit groupe d’amis a décidé de descendre quelques canettes d’une bière encore inconnue, la Shekels. On s’assoit sur l’étroite banquette en ciment, et on goûte la Shekels gardée au frais grâce à des pains de glace car, bien sûr, le courant est coupé.

Surprise, un homme, Eduardo, est content d’entamer la conversation en public. Il est vrai que c’est un voyageur qui a vu d’autres horizons que « Saint Ferdinand des Crevettes » (traduction littérale du nom de la ville, due au fait que la rivière locale abritait une abondance de crustacés). Il est médecin, vétéran des « missions médicales » cubaines. Il égrène avec bonne humeur, dans un mélange réjouissant d’espagnol, d’anglais et de portugais, les nations où il a exercé, et participé à ce pan primordial de l’étrange économie cubaine : Brésil, Venezuela, Gambie, Angola, Afrique du Sud… Son propre pays compte encore environ 30 000 praticiens qui exercent dans le monde entier, comme lui, et qui reversent une partie notable de leur salaire à l’Etat, contribuant significativement à ses ressources en devises.
Mais ce bonheur de raconter son épopée est coupé court par l’inévitable type de la sécurité, avec sa besace sur le ventre, des lunettes de soleil de cycliste, couleur rose dégradé en doré, dont c’est la seule fantaisie. Il le tire à part, l’engueule : « Mais qu’est-ce que tu leur racontes ? Et puis arrête de parler dans toutes ces langues que je ne comprends pas. »Eduardo plaide sa cause, assez fort pour qu’on l’entende, peut-être à cause des Shekels enchaînées, ou pour que toute l’assemblée puisse juger qu’il n’a rien à se reprocher : « Mais je ne leur ai dit que des choses positives sur le gouvernement ! » On venait d’apporter des assiettes remplies de cubes de cochon rôti et de cervelas. Tant pis, il faut repartir.

Pour un peu, on pourrait s’imaginer dans la Roumanie de Ceausescu, dans les années 1980. Une économie à l’agonie, de multiples absurdités, une surveillance maniaque, un parti au pouvoir fossilisé. L’entrée dans Cienfuegos est, à cet égard, comme une plongée dans le temps comparable. Partout, sur les murs des usines ou sur des écriteaux géants, des slogans marxistes exaltant les réussites des travailleurs en train d’édifier le communisme et de vaincre le capitalisme. Dans les grandes avenues désertes qui mènent vers le centre et ses immeubles Rococo, on saisit l’étendue de tout ce qui a été abîmé ici, et ce ne sont pas que des slogans.
La ville, plongée dans l’obscurité, tente de fonctionner cahin-caha, comme si des luddites y avaient pris le pouvoir à la faveur de l’obscurité et cassé toutes les machines. De menus travaux s’effectuent à la lampe de poche, les téléphones sont indispensables pour éviter les flaques d’eau à miasmes qui remplissent les trous de tous formats dans la chaussée. Dans un pays qui soude tout ce qu’il peut pour réparer, bricoler et récupérer ce qu’il ne peut remplacer, il n’est plus possible d’œuvrer sur un poste à souder aux heures normales. Si l’électricité revient dans la nuit, tout un bourdonnement d’activité reprend, autour des usages quotidiens des quelques appareils électriques indispensables à la vie de tous les jours, ou de toutes les nuits. Dans la baie de Cienfuegos, où le corsaire Francis Drake (1540-1596) venait faire relâche à une tout autre époque, on lit, en lettres gigantesques, sur un mur : « Bienvenue dans la Cuba socialiste. »