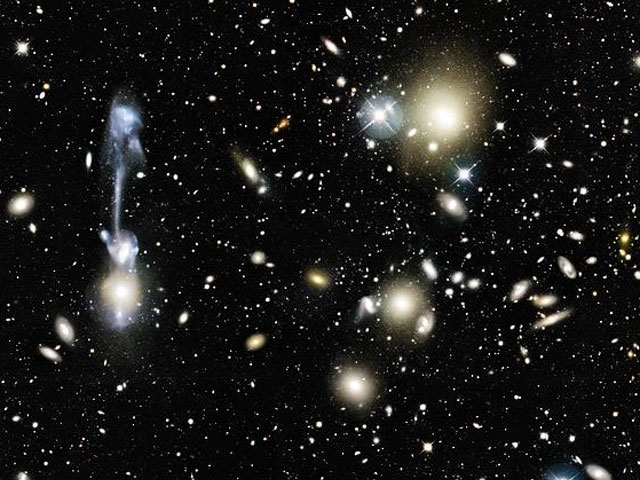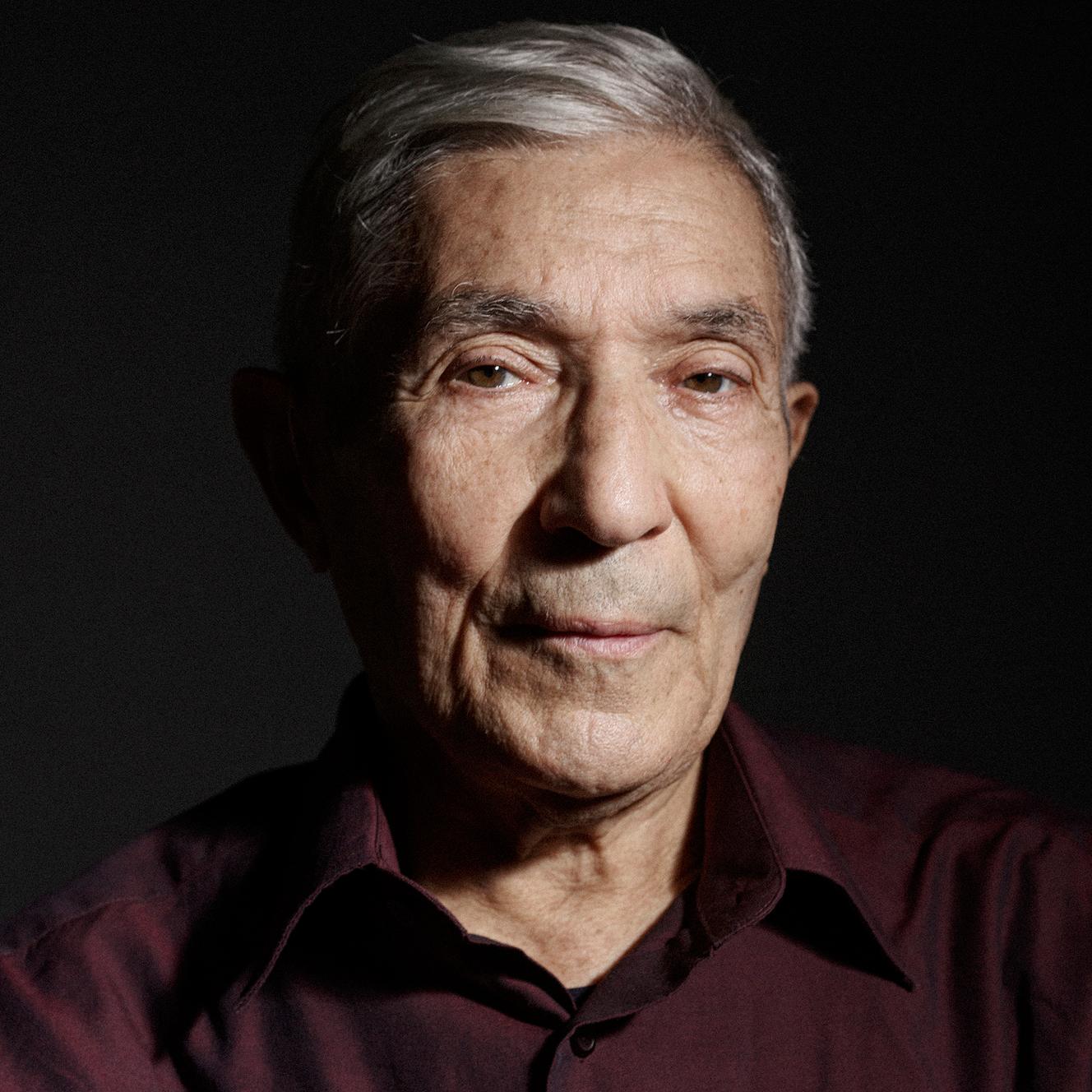A la Fondation Pathé, le cinéma muet géorgien dans toute son originalité et sa drôlerie
Une rétrospective présentée jusqu’au 3 mars dans l’établissement parisien propose de découvrir une vingtaine de films courant de 1922 à 1936, à l’excentricité déjà bien marquée.

Au train où vont les restaurations, la carte mondiale du cinéma n’en finit plus de se déplier sous nos yeux. Aujourd’hui, c’est à la Géorgie que la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, à Paris, consacre sa rétrospective, jusqu’au 3 mars. Consacrée à la mémoire du muet, l’institution remonte ainsi aux sources méconnues de cette « petite » cinématographie, en une vingtaine de films courant de 1922 à 1936. Plus proches de nous, des cinéastes comme Otar Iosseliani (1934-2023) ou Alexandre Koberidze (Sous le ciel de Koutaïssi, 2021) nous avaient déjà renseignés sur un certain penchant local pour l’exubérance et la poésie. Le programme confirme que cette excentricité ne date pas d’hier : le cinéma géorgien s’y révèle dans toute son originalité, sa drôlerie irrésistible, tout en reflétant la sensualité méridionale de cette terre sud-caucasienne mordant déjà sur l’Asie.
Ce n’est pas rien, quand on sait que l’histoire du cinéma géorgien a partie liée avec celle du cinéma soviétique, puisque le pays fut intégré à l’URSS (en 1921), et les studios de Tiflis (l’ancien nom de Tbilissi) une antenne périphérique de Moscou – au même titre que les studios d’Odessa pour l’Ukraine. Dès 1917, les cinéastes géorgiens reçoivent l’impulsion de la révolution et participent de l’élan de l’avant-garde. Mais dix ans plus tard, à la charnière des années 1930, la doctrine officielle met les arts au pas, sous la tutelle du « réalisme socialiste ». Malgré cela, le cinéma géorgien demeurera un irréductible foyer de singularité et d’indiscipline. Ce qui n’empêchera pas bien des œuvres de se heurter à la censure de Moscou, certaines mises sous le boisseau durant des décennies.
Ce fut le cas notamment de Ma grand-mère (1929) de Kote Mikaberidze, sans doute l’œuvre la plus folle de la sélection, un sommet de loufoquerie. Cette satire virulente de la bureaucratie met en scène la déroute d’un gratte-papier licencié d’une grosse agence, sorte de Harold Lloyd géorgien. Pour retrouver un emploi, il doit obtenir une lettre de recommandation d’un bienfaiteur (la fameuse « grand-mère » du titre). Le film est surtout le siège d’un déluge formel ébouriffant. Les trouvailles de l’avant-garde sont mises au service du burlesque, tel le décor futuriste de l’agence en forme de grande horloge déréglée. A la fin, un lettrage animé tonne : « Mort aux bureaucrates ! » Mais l’horizon critique des années 1920, qui était encore celui de Trotski, exilé la même année, s’était refermé. Tombant pile au moment du durcissement stalinien, ce chef-d’œuvre sera accusé de « formalisme » et interdit pendant quarante ans.
Lyrisme échevelé
Mikhaïl Tchiaoureli, lui, n’a pas toujours échappé au rôle de propagandiste (La Chute de Berlin, 1949), dans les petits papiers de Staline, son compatriote d’origine géorgienne. Hors du chemin ! (1931) s’avère toutefois une comédie plus subtile, s’attachant à une petite société d’historiens ayant à cœur de sauver une église byzantine des travaux de rénovation communistes. La satire porte sur l’idéologie petite-bourgeoise qui fétichise le passé et freine le progrès social. Tchiaoureli orchestre ici une ronde de visages outrés et de postures ridicules, hérités d’un théâtre populaire, par une construction de plans dynamiques, toujours surprenants.
Dans son cinéma, la Géorgie est généralement le siège d’un rapport au passé si lointain – celui de l’antique Colchide – qu’il pose problème au jeune soviétisme. Dans Le Sel de Svanétie (1930), Mikhaïl Kalatozov filme le village d’Ouchgouli, à 2 000 mètres d’altitude, où la vie est restée dans ses formes féodales, à l’abri de menaçantes tours de garde médiévales. Si le propos est progressiste (bientôt les routes viendront désenclaver le site), le filmage lui, enrobe cette paysannerie minérale d’un lyrisme échevelé. C’est un autre village montagneux coiffé par un glacier que filme Nutsa Gogoberidze, dans son documentaire Buba (1930), d’un réalisme puissant. De cette pionnière des réalisatrices géorgiennes, formidable cinéaste, on pourra également découvrir la fiction Ujmuri (1934), où l’assèchement d’un marais se heurte aux croyances locales, en la personne d’une vieille sorcière se disant reine des grenouilles. Gogoberidze transcende l’attendu propagandiste par sa façon de confronter les êtres et leur environnement, de faire droit à tous les points de vue, y compris les plus archaïques – le film sera de ce fait interdit lui aussi.
Le passé se rappelle également dès lors qu’il s’agit d’évoquer l’arbitraire de l’ancien régime, comme dans Eliso (1929) de Nikoloz Chenguelaïa, une splendide fresque historique tournée dans les plateaux du haut Caucase. Le récit revient en effet sur l’expropriation illégitime de villages tchétchènes par les troupes du tsar en 1864. A la perfidie et à la trahison impériale, les habitants jetés sur les sentiers, devenus cortèges de vagabonds, répondront par une scène de danse extraordinaire, élan adressé au ciel. Sarabande, sauts, tambours et arabesques affolent le montage, exaltent l’image, et le muet devient pure musique visuelle. Faire dérailler le récit par le mouvement, voilà toute la sève du cinéma géorgien.
[Source: Le Monde]