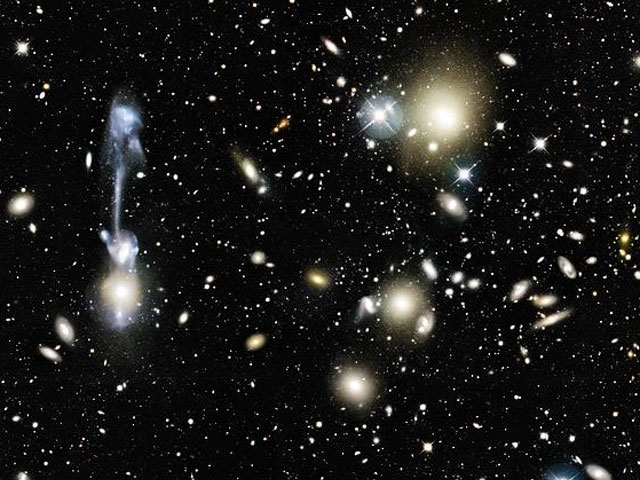Au Maroc, les promesses démocratiques non tenues de la réforme constitutionnelle de 2011
Adoptée voici tout juste quinze ans, dans la foulée des « printemps arabes », la nouvelle loi suprême du royaume était présentée comme un « compromis historique ». Mais le texte a fini par être vidé de sa substance.

Il aura fallu que la vague de manifestations, commencée le 20 février 2011 dans l’élan des « printemps arabes », soulève une partie du Maroc pour que Mohammed VI accepte enfin de modifier la Constitution du royaume. Depuis son intronisation en 1999, il s’était refusé à sauter le pas, malgré les demandes de la société civile et de partis politiques, avant de finalement céder devant l’ampleur d’une contestation populaire sans précédent sous son règne. Aussi la réforme se voulait-elle à la hauteur des attentes exprimées dans la rue. « Un nouveau pacte entre le trône et le peuple », synonyme de « consolidation de l’Etat de droit », selon le monarque et son entourage. Mais quinze ans après, force est de constater que cet aggiornamento a produit bien peu d’effets.
Le palais avait pourtant présenté la nouvelle Loi fondamentale comme le résultat d’un « compromis historique ». « Une réforme globale, audacieuse et avant-gardiste » actant l’élargissement des libertés individuelles et l’affirmation du principe de séparation des pouvoirs et d’indépendance de la justice. La Constitution offrait même une nouvelle section sur les droits fondamentaux des citoyens, inscrivant dans le marbre, pour la première fois, les mots « torture »,« détention arbitraire » et « corruption ». Tout un symbole.
Dans une prise de parole publique rare, le chef de la diplomatie, Taïeb Fassi-Fihri, avait dressé, en mars 2011, la liste des maux qui rongent le Maroc et auxquels la réforme de la Constitution devait apporter des réponses. « Un taux de chômage élevé, y compris parmi les jeunes diplômés, de fortes disparités sociales, un sentiment prégnant d’injustice et d’exclusion et, enfin, des problèmes de gouvernance et de transparence », détaillait, dans Le Monde, celui qui sera nommé, en 2012, conseiller de Mohammed VI.
Un « village Potemkine »
Que s’est-il passé depuis ? Le bond en avant du Maroc est spectaculaire dans certains domaines, comme les infrastructures. Les indicateurs liés aux conditions de vie en général s’améliorent eux aussi. Ils ont fait entrer le royaume, en mai 2025, dans la catégorie des « pays à développement humain élevé » selon les critères des Nations unies. Mais les données officielles ne reflètent pas la précarité de la population. A bien des égards, le Maroc demeure un « village Potemkine », où les façades des grands chantiers peinent à cacher les fissures menaçant les fondations : la moitié des urbains entre 15 et 24 ans est au chômage, le taux d’activité des femmes est en dessous des 20 % et un quart des Marocains ne savent toujours ni lire ni écrire.
A cette réalité sociale s’ajoute une justice dont « les pouvoirs perdent du terrain face à l’ingérence excessive du pouvoir exécutif », selon l’indice 2025 de l’ONG World Justice Project. La lutte contre les conflits d’intérêts a beau avoir été constitutionnalisée, l’Etat marocain continue d’être dirigé par des hommes d’affaires. A commencer par son chef, Mohammed VI, qui possède deux des trois plus grosses capitalisations boursières du pays, ainsi qu’une foule de sociétés non cotées. Sans parler du premier ministre, Aziz Akhannouch, leader national de la distribution de carburant, un secteur ô combien dépendant des pouvoirs publics.
La Constitution, adoptée par référendum le 1er juillet 2011, « n’a pas démocratisé le Maroc », observe le politologue Mohammed Madani. « Réponse conjoncturelle » à une situation d’effervescence sociale, ce vote, acquis à plus de 98 %, aura surtout permis à la monarchie de se ressourcer. En revanche, l’application des droits contenus dans le texte n’est, elle, toujours pas garantie. Les acteurs associatifs alertent sur la répression des voix discordantes, parlant de « régression » par rapport au début du règne de Mohammed VI.
Vœu pieux
Il suffit de constater le nombre d’arrestations qui frappent la « gen Z » marocaine, dont le mouvement, porté par une jeunesse avide de changement, a battu le pavé entre septembre et octobre 2025. Près de 5 700 personnes ont été interpellées, selon un décompte de l’Association marocaine des droits humains. Dans son discours de rentrée parlementaire, le roi a pourtant repris à son compte les griefs des manifestants, assurant qu’il ne devrait y avoir « ni antinomie ni rivalité » entre les investissements colossaux consacrés à l’organisation de la Coupe du monde de football 2030 et ceux, bien moindres, dévolus aux services publics d’éducation et de santé. Entre les déclarations d’intention et les faits, le décalage est saisissant.
Dans ces conditions de verrouillage de la liberté d’expression, comment « généraliser la participation de la jeunesse au développement du pays », comme l’exige la Constitution ? A tous points de vue, l’implication du peuple dans le débat national est un vœu pieux. L’exception d’inconstitutionnalité, qui doit permettre aux citoyens de contester la conformité des lois, n’est toujours pas effective. Quant au droit d’accès à l’information, il est inapplicable car sévèrement restreint. Les structures d’intermédiation, elles, sont atones.
Le renforcement du statut du premier ministre en tant que chef de l’exécutif – il doit être nommé par le roi au sein du parti victorieux des élections – n’a pas non plus réduit l’emprise du roi sur le jeu politique. La fragmentation de l’offre partisane (38 partis), encouragée par le palais, et la loi électorale empêchent toute formation d’obtenir suffisamment de sièges pour concurrencer la monarchie. Pourtant, « les Marocains ont pris conscience de leurs droits et ne veulent plus se laisser faire », estime le vice-secrétaire du Parti socialiste unifié, Abdullah Abaakil. Pour beaucoup de protestataires de 2011, le seul gain obtenu ce printemps-là n’est pas la Constitution, vidée de sa substance, mais la libération de la parole.
[Source: Le Monde]