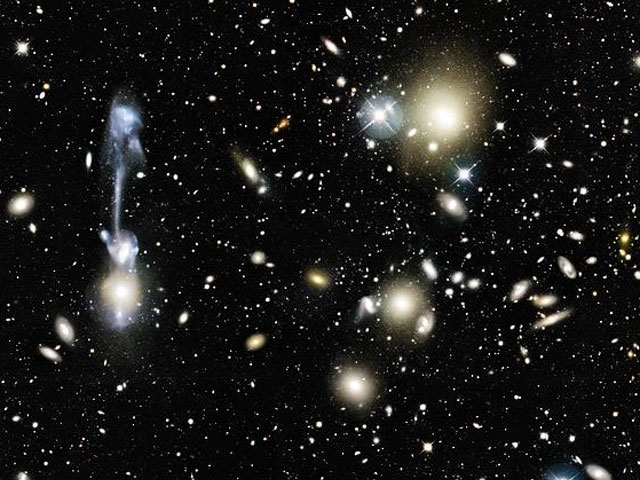Le travail au noir comme « technique de survie » pour les étudiants
Privés de ressources suffisantes pour vivre, de nombreux étudiants se tournent vers des activités non déclarées. Garde d’enfants, restauration, chantiers : derrière ces petits jobs en apparence anodins se cachent précarité, renoncements et risques juridiques.

Neuf mètres carrés. Un lit, un bureau, quelques affaires entassées dans un coin. Dans son studio d’une résidence du Crous, Charlotte (le prénom a été modifié à sa demande), étudiante en première année à l’Institut de formation en soins infirmiers de Nice, passe ses comptes au crible : 500 euros de bourse pour tenir le mois, 250 euros de loyer, le reste pour manger, s’assurer, se déplacer… « Littéralement pas assez », retrace-t-elle trois ans plus tard. Elle tente de travailler en étant déclarée, mais lorsqu’elle dépose des CV dans les bars et les restaurants, on ne lui propose que du travail non déclaré. « Quand t’as pas le choix, tu prends ce qu’il y a », résume l’étudiante.
Après sa première année, Charlotte décroche son diplôme d’aide-soignante. Par le biais de la mère d’une amie, elle trouve des soins à domicile chez une dame, au noir. Horaires souples, au gré des appels. Et un salaire intéressant : deux semaines par mois suffisent souvent à générer près de 3 000 euros, réglés en cash par le fils de la résidente. « C’était mieux rémunéré qu’un emploi déclaré, donc je n’ai pas hésité », explique la jeune femme de 21 ans. Elle y restera deux ans. A l’été 2025, à l’issue de sa troisième année, elle passe finalement en CDD à l’hôpital, un poste « plus stimulant sur le plan médical ».
De ces années de travail non déclaré, l’Etat ne saura sans doute jamais rien. Travailler « au noir », c’est exercer sans contrat et sans déclaration à l’Urssaf, l’organisme qui collecte les cotisations des employeurs. Et cela signifie surtout renoncer à ses droits, cotisations pour la retraite, chômage, et à toute protection en cas d’accident ou de maladie professionnelle.
« Peu importe le cadre »
En 2019, environ 5 % des adultes en France exerçaient ce type d’activité, d’après le Conseil d’orientation pour l’emploi. Dans une étude publiée en 2021 sur le site de l’Insee, Olivier Bargain et Laila Ait Bihi Ouali estiment que le travail non déclaré pèse entre 3 % et 4 % de l’activité économique. « En France, la grande partie des activités non rémunérées sont des petits jobs d’appoint, exercés en parallèle d’un poste légal », explique Olivier Bargain, professeur d’économie à l’université de Bordeaux et membre de l’Institut universitaire de France. Parmi les 8,6 % des Français qui ont déjà exercé un emploi dissimulé, près de 18,2 % sont des étudiants, selon une enquête menée entre 2012 et 2015 par le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie.
Les réseaux sociaux facilitent la circulation des missions informelles : baby-sitting, cours particuliers, restauration… Des annonces y fleurissent, souvent estampillées « de toute urgence ». En face, des jeunes, souvent issus de milieux modestes, répondent aux annonces ou en publient eux-mêmes, se disant « prêts à faire n’importe quel travail ».
Pour ces derniers, l’illégalité est une « technique de survie », analyse Jérôme Heim, chercheur à la haute école de gestion Arc de Neuchâtel (Suisse), et coauteur de l’ouvrage Le Travail au noir. Pourquoi on y entre, comment on en sort ? (L’Harmattan, 2011). Les conséquences à long terme sont rarement anticipées, pointe le docteur en sciences humaines : « Les cotisations ne sont souvent pas une priorité pour ces étudiants, qui pensent accéder plus tard à des situations professionnelles plus confortables et pouvoir compenser ce qu’ils n’ont pas cotisé. »
Fille d’une mère célibataire exerçant comme femme de ménage, Charlotte comprend dès le lycée que l’argent est un ticket d’entrée social : « Quand tout le monde va manger dehors pour 5 ou 10 euros et que tu n’as pas la somme, tu restes à l’écart. Alors, peu importe le cadre, il faut gagner de l’argent si on ne veut pas être exclu. »
Livraisons de pizzas jusqu’à 23 heures
Sonia (qui n’a pas souhaité donner son nom de famille) aussi a appris à enchaîner les emplois non déclarés dès ses 16 ans. Avec un père professeur à la retraite et une mère sans profession, elle compte chaque euro. Pendant la pandémie du Covid-19, ses deux premières années de licence d’histoire à Paris-Panthéon-Sorbonne se passent chez ses parents. Avec 350 euros par mois de bourse, elle dépense peu et met de côté.
Lorsque la liberté revient, Sonia comprend que cette somme permet de tenir, mais pas de vivre. Elle se tourne alors vers le travail au noir. En master 1, elle donne des cours particuliers à trois élèves, près de dix heures par semaine, pour 300 à 500 euros par mois. Un rythme qui grignote une partie de son temps libre, sans lui donner le sentiment de « sacrifier quelque chose ». Durant son master 2 d’histoire, elle passe par une plateforme de cours particuliers déclarés pour être mieux rémunérée. Ses revenus montent alors de 400 à 600 euros par mois. Aujourd’hui diplômée, elle a choisi d’arrêter pour se concentrer sur la préparation de l’agrégation : elle vit de ses 530 euros de bourse par mois. L’an prochain, à 25 ans, si tout se passe comme prévu, elle devrait être professeure. « Je n’envisagerai plus de faire des petits boulots en parallèle », dit-elle. Sauf, pourquoi pas, dans la restauration, « où les tarifs restent bien avantageux ».
Dernier d’une fratrie de cinq enfants, élevé par une mère infirmière, Guillaume (qui n’a pas souhaité donner son nom de famille), 21 ans, étudiant en master d’ingénierie d’affaires à l’Idrac, a grandi avec l’idée qu’il fallait se débrouiller seul : « Dans mon milieu, je n’ai jamais envisagé de demander des sous. » Depuis ses 16 ans, âge légal pour travailler, il cumule les missions, toujours payées en liquide : « Quand tu repars avec 100 euros dans ta poche après une longue journée au chantier, tu respires. »
Ses petits boulots ont parfois pesé sur son BTS en management commercial opérationnel. Bien que ses absences en cours fussent « rares », le jeune homme se souvient d’avoir manqué une journée clé de préparation pour son grand oral, contraint par une mission qu’il ne pouvait refuser. Quatre soirs par semaine durant son BTS, une fois les cours terminés, il enchaîne les livraisons de pizzas jusqu’à 23 heures : « On me filait 8 euros de l’heure, et je comptais sur les pourboires. » Il rentre chez lui après minuit, avec l’obligation d’être en classe dès 8 heures le lendemain matin. Derrière ce petit salaire, la protection n’est pas garantie. « C’est le pire taf », lâche-t-il.
En février 2024, Guillaume chute de son scooter. A terre, le bras cassé, la panique le saisit : il n’est pas déclaré. Aux urgences, son manager arrive, confiant. Le travailleur découvre alors qu’un contrat de cinq heures par mois a été bricolé à son insu. Juste assez pour couvrir l’entreprise, trop peu pour toucher une indemnisation complète. « Je me dis que je fais ça pour rien. Ils profitent de la misère des autres », souffle-t-il, amer. Après cela, Guillaume a cessé de travailler au noir. Ou presque. De temps en temps, confie-t-il, il continue à faire quelques « extras » pour des proches.
[Source: Le Monde]