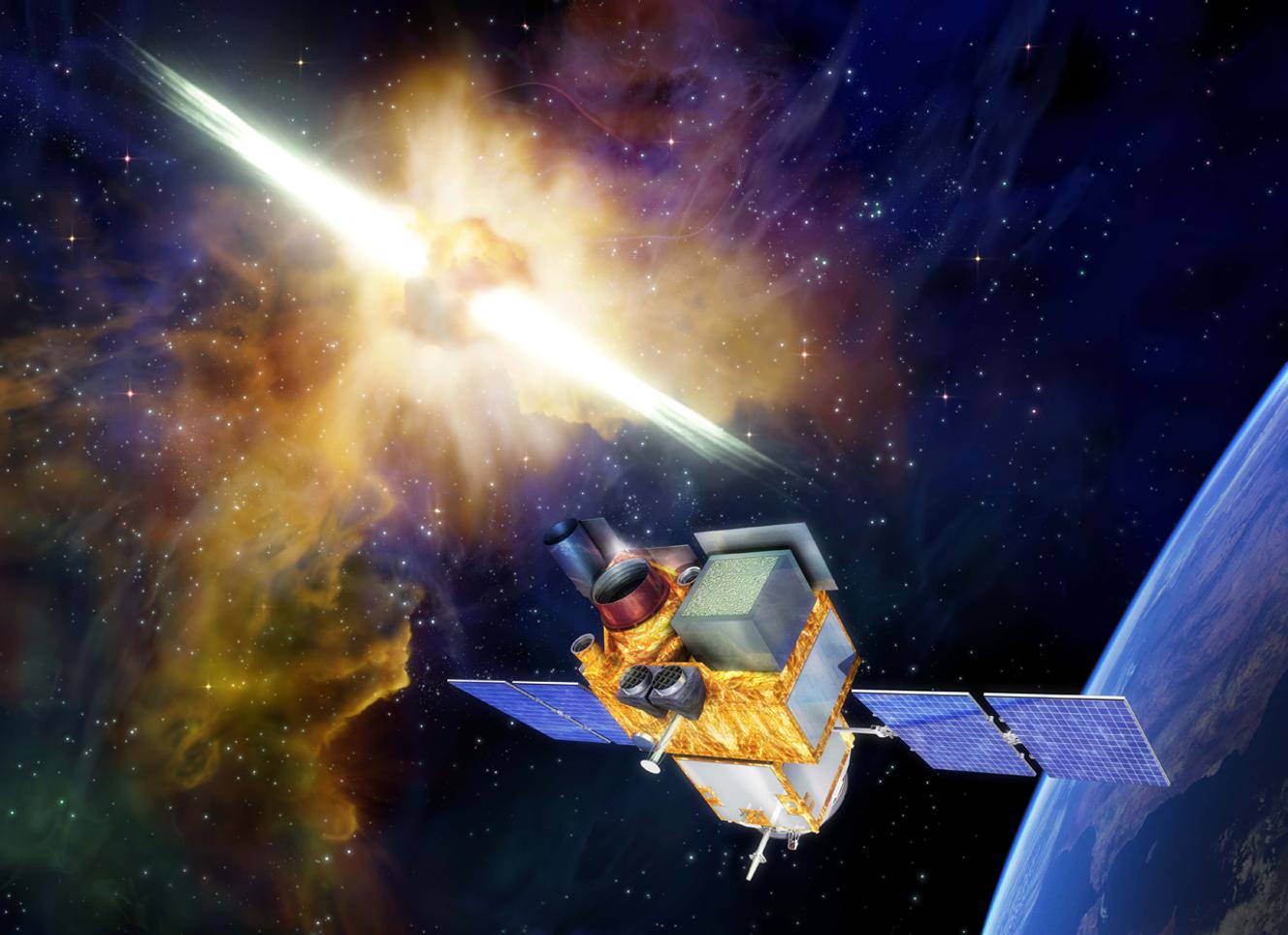En Syrie, quatre mariages pour une réconciliation
A Lattaquié, sur le littoral syrien, théâtre de tueries visant la minorité alaouite dont est issu le clan Assad, quatre couples de confession sunnite et chiite se sont unis lors d’un mariage collectif. Une façon de lutter contre les divisions communautaires qui déchirent le pays, comme vient encore de le montrer l’attentat du 22 juin contre une église à Damas.

Le sol est jonché d’épingles à cheveux et l’odeur des mèches, surchauffées par le souffle du séchoir, embaume la salle. Entassées sur des étagères, des couronnes de faux diamants attendent d’auréoler les têtes. Une esthéticienne effectue quelques pas de danse sur les notes d’une chanson pop.
Dans ce salon de beauté en sous-sol d’un immeuble de Lattaquié, une ville de la côte nord-ouest de la Syrie, ancien fief de la famille Al-Assad, quatre femmes se préparent en ce début du mois de juin à célébrer leurs noces respectives au cours d’un mariage collectif regroupant plusieurs confessions.
Dans l’embrasure de la porte, un homme passe une tête. Dans la précipitation, deux des futures mariées dissimulent leurs cheveux et visage en protestant. Car elles sont de confession sunnite. Les deux autres sont alaouites, une branche de l’islam chiite, aux mœurs et croyances différentes.
« On est fiancés depuis un an et demi, depuis qu’Achraf est tombé en panne devant chez moi », raconte en souriant Roula Salman. « En se mariant ainsi, on voulait montrer que la Syrie était toujours unie », ajoute la jeune femme de 27 ans, étudiante en physique à Lattaquié. Un choix inédit et symbolique dans un contexte très tendu. Dimanche 22 juin, un attentat-suicide a ainsi visé l’église Saint-Elie, à Damas, faisant au moins 25 morts et une soixantaine de blessés parmi les chrétiens rassemblés.
Calme précaire
En mars, une vague de massacres ciblant majoritairement la communauté alaouite – cette minorité religieuse à laquelle appartient le clan Assad représente environ 10 % de la population syrienne – a fait au moins 1 700 victimes civiles, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme. Des centaines de vidéos de meurtres et de pillages ont déferlé sur les réseaux sociaux, incriminant des factions armées extrémistes, pour certaines affiliées au nouveau régime dirigé par le président par intérim Ahmed Al-Charaa, un sunnite et ancien chef djihadiste.
Un calme précaire est revenu sur la côte, mais les invités ne sont pas tous sereins, d’autant que le lieu des festivités se situe à quelques kilomètres seulement du quartier d’Al-Dattour, où, le 4 mars, deux soldats du ministère de la défense ont été tués dans une embuscade tendue par des fidèles du régime de Bachar Al-Assad. « Et si des hommes armés venaient se venger pendant la fête ? », murmure une hôte.

L’appréhension semble se dissiper lorsque les quatre couples font leur entrée. Un pharaon géant en carton-pâte fait office de porte. Avalés par cette silhouette kitsch et majestueuse, les mariés défilent au son de la traditionnelle musique de noce de la chanteuse libanaise Majida El Roumi. Autour d’eux, les familles sont réparties le long de grandes tablées. Une forêt de bras tendus, téléphone à la main, tente de capturer l’instant.
Dès l’ouverture de la cérémonie, tout est fait pour célébrer l’idée du vivre-ensemble. Les enceintes diffusent un fond sonore mêlant l’appel du muezzin aux tintements des cloches d’église – bien qu’il n’y ait pas de couple chrétien. Deux enfants d’honneur proclament au micro : « Bienvenue dans la nouvelle Syrie ! » Les regards des quelque 200 convives se croisent, curieux et émus d’être rassemblés ici.
« Promouvoir la paix civile »
A l’origine de cette cérémonie singulière, Ayman Sejari et sa sœur Jihan, deux quinquagénaires. Quand la dictature de Bachar Al-Assad est tombée, le 8 décembre 2024, renversé par Ahmed Al-Charaa et son organisation islamiste Hayat Tahrir Al-Cham (HTC) –, marquant la fin de quatorze années de guerre civile, ils ont ressenti l’urgence de relancer cette initiative mise sur pause depuis la révolution de 2011. « Avant la guerre, on était très impliqués dans de nombreux projets humanitaires. On a lancé les mariages collectifs en 2009 », explique Jihan Sejari.
Dans ce duo sunnite issu d’une famille aisée, Jihan Sejari veille sur les mariés quand Ayman orchestre la logistique de la cérémonie. « Avant la guerre, notre objectif était de soutenir les plus modestes. Maintenant, le but est surtout de promouvoir la paix civile », poursuit-elle.
Alors, pour s’assurer de la compatibilité des couples avec le projet, les organisateurs les ont triés sur le volet, en menant des entretiens. « La plupart des questions cherchaient à savoir si l’on était favorable au vivre-ensemble », explique Marina Hassan, 32 ans, une des mariées de confession alaouite.

La musique, forte, oblige les convives à se rapprocher pour s’entendre. « J’espère que les minorités comprendront que les sunnites ne cherchent ni vengeance ni violence », insiste Yasser Sharaf Al-Din, le visage fermé. Depuis sa table excentrée, ce professeur de mathématiques de 46 ans, sunnite, observe la salle.
Il a accompagné ses deux cousins Muhammad et Nasra Sharaf Al-Din – sunnites également – à leurs noces depuis Idlib, à 120 kilomètres au nord-est de Lattaquié. Marqué par les années de guerre – il élève seul sa nièce depuis la mort de son frère dans un bombardement –, il ne nourrit pourtant aucune rancœur. « Cette idée du mariage collectif m’a tout de suite plu », ajoute-t-il, esquissant un sourire.
« J’espère que vous aurez une famille heureuse »
Ce mariage vise à rassembler toutes les communautés après des décennies de divisions orchestrées par la famille Assad. « Dès les années 1970, le régime a mis en place un millefeuille administratif et divisé les territoires pour allouer plus de ressources publiques à certaines franges de la communauté alaouite, favorisant certains clans à travers des postes-clés dans l’administration et dans l’armée, détaille le docteur en science politique, relations internationales Aghiad Ghanem, qui enseigne à Sciences Po Paris. Il a aussi entretenu l’idée d’une côte ultraprivilégiée par rapport au reste de la Syrie », renforçant le ressentiment entre communautés. Il suffit de parcourir les villages de la région côtière pour constater une réalité plus contrastée.

« La liberté retrouvée n’est pas seulement pour les sunnites, mais pour toute la société syrienne : alaouites, chrétiens, kurdes… », déclare le cheikh Fidaa Al-Majoub, influent chef religieux sunnite de Lattaquié.
Sa voix porte dans la salle, interrompant brièvement les conversations des convives attablés devant leur part de gâteau. Ayman et Jihan Sejari ont invité des figures de la société civile côtière, certaines tout juste rentrées d’exil. Ce mariage a aussi des allures de grand rendez-vous d’anciens opposants au régime.
« J’espère que vous aurez une famille heureuse, des enfants », poursuit le cheikh. Une invitée l’interrompt en criant : « Quand vous accoucherez, appelez-moi ! » L’assemblée rit aux éclats aux propos de la sage-femme. Et, comme si cet épisode avait autorisé les familles à se détendre, elles se pressent désormais autour des mariés pour les photos.
Paix fragile
Dans l’effervescence, la silhouette de Sabah Karoum, la mère de Somar Tféhia – marié à Marina –, avance lentement vers l’estrade à l’aide d’un déambulateur. « On ne s’attendait pas à ce que le mariage ait lieu. On a fait le trajet de chez nous à 30 kilomètres d’ici grâce à notre voisin. C’était très calme sur le chemin », confie-t-elle, encore incrédule. La côte syrienne reste agitée et la paix, fragile. Deux semaines plus tôt, cinq alaouites ont été abattus par des hommes armés à Mashqita, non loin d’ici. Dans la campagne, rares sont les habitants qui osent quitter leur domicile après la nuit tombée.
Face aux violences, l’allocution d’Ahmed Al-Charaa, le 22 décembre 2024, résonne comme un écho lointain : « La Syrie est un pays pour tous et nous pouvons coexister ensemble », avait-il déclaré. Cela n’a pas empêché certaines factions affiliées à ce nouveau pouvoir de commettre des meurtres sur la côte, par esprit de vengeance contre des membres de la communauté alaouite.
Le nouvel homme fort de Damas avait alors appelé à l’unité nationale et à la paix civile. Depuis, la commission d’enquête qu’il a lui-même nommée sur les exactions commises sur le littoral depuis la chute de l’ancien dictateur a repoussé la remise de son rapport d’avril à juillet. Aucun acte de justice n’a encore été annoncé ni aucun responsable inquiété, laissant un silence lourd face aux paroles des familles endeuillées.
Elan de solidarité
Au-delà du symbole, ce mariage collectif permet aussi de soulager économiquement les familles : la cérémonie est entièrement prise en charge, dans un vaste élan de solidarité intercommunautaire. Le lieu de réception est fourni par une connaissance chrétienne d’Ayman et Jihan Sejari ; les robes, habituellement louées entre 600 et 1 200 dollars (entre 520 et 1 040 euros environ) la soirée, sont prêtées, comme sont offerts la coiffure et le maquillage.
« Nous n’avons pas réussi à trouver d’autres financements pour couvrir les coûts restants, car la situation économique s’est encore dégradée depuis la libération », souligne Jihan Sejari. Le frère et la sœur ont contribué avec leur argent personnel. Au total, « un peu plus de 2 000 dollars [1 740 euros environ] ont été nécessaires pour faire aboutir le projet », explique-t-elle.
Il est 21 heures quand le mariage touche à sa fin, sans pas de danse esquissé. Mais tous les invités, sunnites et alaouites confondus, se serrent la main. A la sortie, les familles chargent, dans leurs voitures, les réfrigérateurs et les fours offerts aux jeunes mariés. Les quatre couples ont promis de se retrouver bientôt pour une escapade en bord de mer.