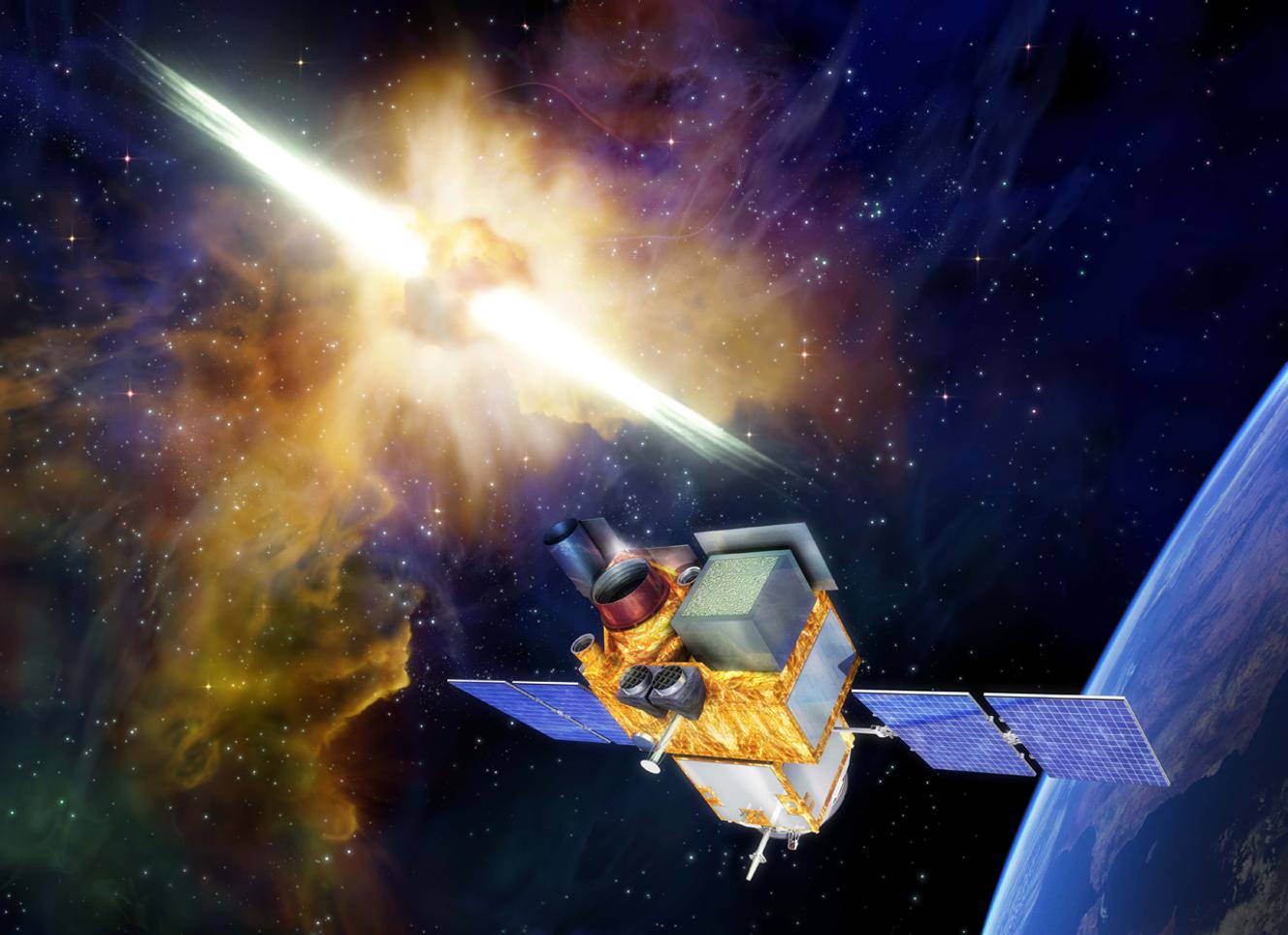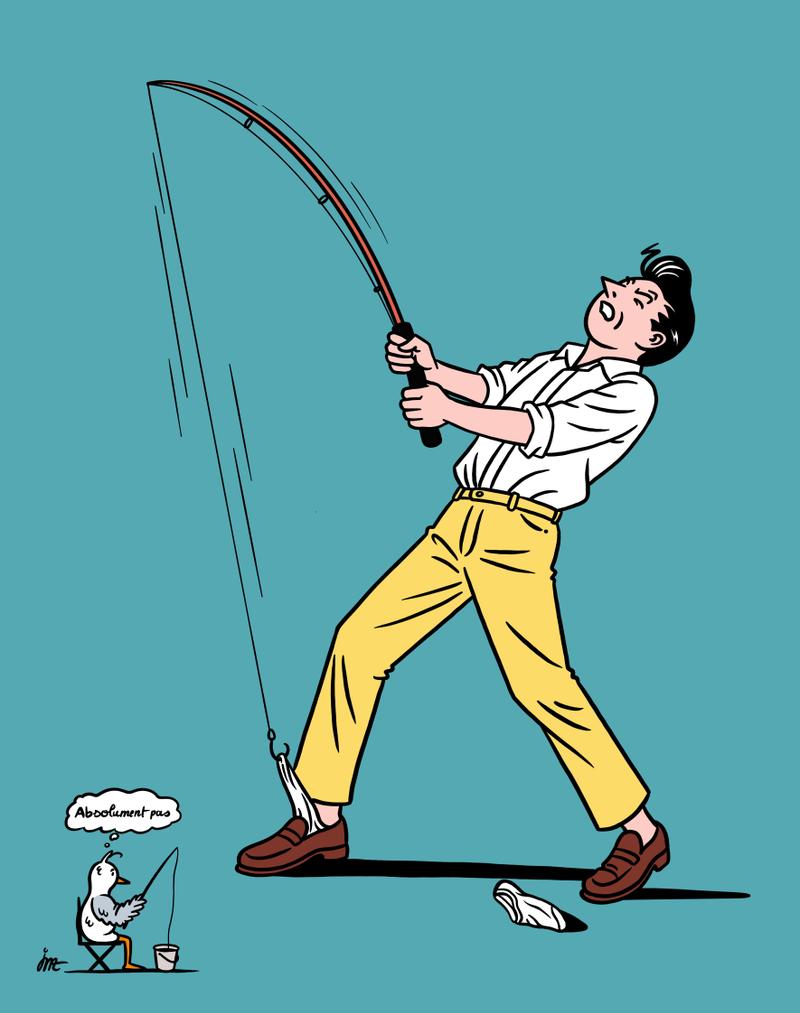« La vente de ma maison d’enfance a été un bouleversement et une énorme perte d’ancrage »
« Premières fois » : récits de moments charnières autour du passage à l’âge adulte. Cette semaine, Jeanne (le prénom a été modifié), 35 ans, se souvient du deuil qu’elle a dû entreprendre, durant sa vingtaine, quand la maison où elle a grandi a été vendue.

La première fois que j’ai compris que nous allions devoir nous séparer de ma maison d’enfance, j’avais 20 ans. Mes parents venaient de nous annoncer qu’ils divorçaient. Comme mon père changeait de ville et que ma mère ne pouvait racheter sa part de la maison, il fallait mettre en vente cet endroit dans lequel j’avais grandi depuis mes 8 ans. Cela a été un bouleversement et une énorme perte d’ancrage. D’abord, parce que je me disais que, avec cette vente, la famille allait mourir une deuxième fois, car il n’existerait plus cet espace pour se souvenir qu’elle avait existé. Mais aussi, parce que j’ai un rapport très fort aux lieux, et avais construit un attachement puissant à cette maison qui était très singulière.
Plantée dans un lotissement tout ce qu’il y a de plus banal de la périphérie de Rennes, elle détonnait par sa grandeur, et par le projet un peu particulier qui avait été celui des propriétaires qui l’avaient fait construire avant nous. Elle était imposante, avec un corps principal et deux avancées sur les côtés, type château. Tout y était très théâtral, avec des fausses moulures partout et de la tapisserie rose saumon qui étaient là à notre emménagement : un look qui copiait de manière assez amusante une ambiance bourgeoise, alors qu’on habitait dans un espace pavillonnaire classique.
Mes parents sont mélomanes, et cette maison est très liée à la musique, dans mon esprit. Immense, elle nous offrait beaucoup d’espace à mon frère et à moi. Chez nous, il y avait du monde tout le temps. Ma mère est très ouverte et elle aimait que la maison soit remplie. Rapidement, elle est aussi devenue l’endroit pour inviter nos propres amis. Elle a été associée aux fêtes avec nos bandes de potes communs, qu’on avait constituées petits au village. Cette maison a ainsi été le théâtre de cette adolescence-là, et des premières amours. Elle fait tout autant partie de la vie de mes amies.
« Port d’attache »
Quand elle est mise en vente, je suis déjà adulte. J’ai quitté le foyer familial pour suivre mes études d’architecture à Nantes. Je reviens quand même tous les week-ends ou presque. Je suis quelqu’une qui a toujours beaucoup voyagé, et aimé partir, bouger. Mais la maison était comme le port d’attache où je pouvais revenir à tout instant. Quand il a fallu s’en séparer, j’ai compris que ce qui me permettait cette légèreté au voyage et à l’aventure était la présence immuable de cette maison, d’un chez soi. Il pouvait se passer n’importe quel chagrin, n’importe quel défi, je savais qu’il y aurait toujours un train pour m’y ramener.
Elle était tellement atypique dans ses dimensions que la vente a pris du temps. J’ai passé les deux ans qui ont suivi à essayer de documenter chacun de ses recoins, par des photos et des vidéos. A chacun de mes passages, je capturais les lumières qui baignaient les pièces. J’ai voulu garder des traces des habitudes et petits moments qui paraissent anodins, mais font partie du cadre : ma mère qui cuisine, les premiers repas de l’année sur la terrasse, le poulet du dimanche midi, le retour de marché. J’ai ressenti aussi le besoin d’écrire une lettre à l’attention de cette maison, pour acter symboliquement la fin d’un chapitre.
Je suis en Allemagne à ce moment-là, où je suis partie pour une année Erasmus. Là-bas, je découvre le mot heimat, qui désigne le « chez soi », l’endroit « d’où on vient », où on se sent aligné. Il recouvre une signification plus philosophique de la notion de maison : cela peut être effectivement la ville ou l’habitation où on est né, mais aussi une forêt, un bout de chemin, une montagne, et peut se révéler plus tard dans la vie. Avec la vente de la maison, je comprends qu’il me faut me réinventer mon propre « chez moi », dans un sens qui ne sera pas forcément celui du lieu d’origine, mais plus mouvant.
« Un déchirement »
Le jour où la vente est finalisée, je suis toujours à l’étranger. Mon frère organise une grande et ultime fête dans la maison, avec notre bande d’amis. Je ne peux m’y rendre et c’est un déchirement. En même temps, j’ai un peu honte d’être autant bouleversée. Perdre sa maison d’enfance à la vingtaine a cela de particulier que c’est une période de la vie où l’on veut à tout prix se penser déjà adulte. Je me disais que je devrais déjà être ailleurs, prendre pleinement mon envol, et cela a été difficile d’avouer l’impact que ça avait sur moi.
Mais à 20 ans, tu es aussi dans une période où tu ne t’es pas encore déposée dans un autre lieu. Après ça, j’ai été en quête pendant des années d’un lieu où me sentir à nouveau à la maison. J’ai eu beaucoup de logements temporaires, où je ne posais pas tout à fait mes bagages. Mais j’ai eu la chance que ma mère ait toujours, par la suite, fait en sorte de choisir des logements où j’avais une chambre, ce que tous les parents ne font pas au départ de leur enfant.
Entre-temps, j’ai émigré au Québec, et ce sont donc plus que jamais des questions qui me traversent : c’est où chez moi ? Dernièrement, j’ai pu m’installer dans une maison qui a été un espace très important pour me retrouver, et reconstruire un port d’attache, à l’âge de 34 ans – c’est tard. Quand je suis retournée cet hiver chez ma mère – qui, après beaucoup de recherches, a elle aussi posé ses valises, près de Saint-Malo –, cela m’est venu comme une évidence : chez moi, ce n’est plus chez elle, c’est là-bas, dans la région où j’ai construit ma vie au Canada.
« Ces liens qu’on tisse »
J’habite au sud du Québec, au sein d’un village de 1 200 habitants, tourné vers l’agriculture. J’y ai découvert et intégré une communauté de voisinage très solidaire. Et désormais, je comprends encore un peu plus le sens large d’heimat. J’ai encore besoin d’avoir un logement dans lequel je me sens bien – et c’est une gageure, car le propriétaire de la maison où je me trouve a décidé de récupérer son bien et je dois à nouveau déménager. Mais mon « chez moi », c’est avant tout cette communauté, cette région, ces personnes et ces liens qu’on tisse.
Ce sont aussi d’autres lieux, où je ne me rends pas au quotidien mais qui m’habitent. Comme cette plage, située juste à côté de chez ma grand-mère, dans le nord de la Bretagne, qui est l’endroit que je convoque le soir quand j’ai besoin d’être apaisée.
Après le décès de ma mamie, au moment du Covid-19, j’ai récolté une poignée de sable, que j’ai cousue dans une poche intérieure d’un manteau qui lui appartenait. Je le porte très régulièrement, et à travers lui, le souvenir de ce bout de « chez moi ».
[Source: Le Monde]