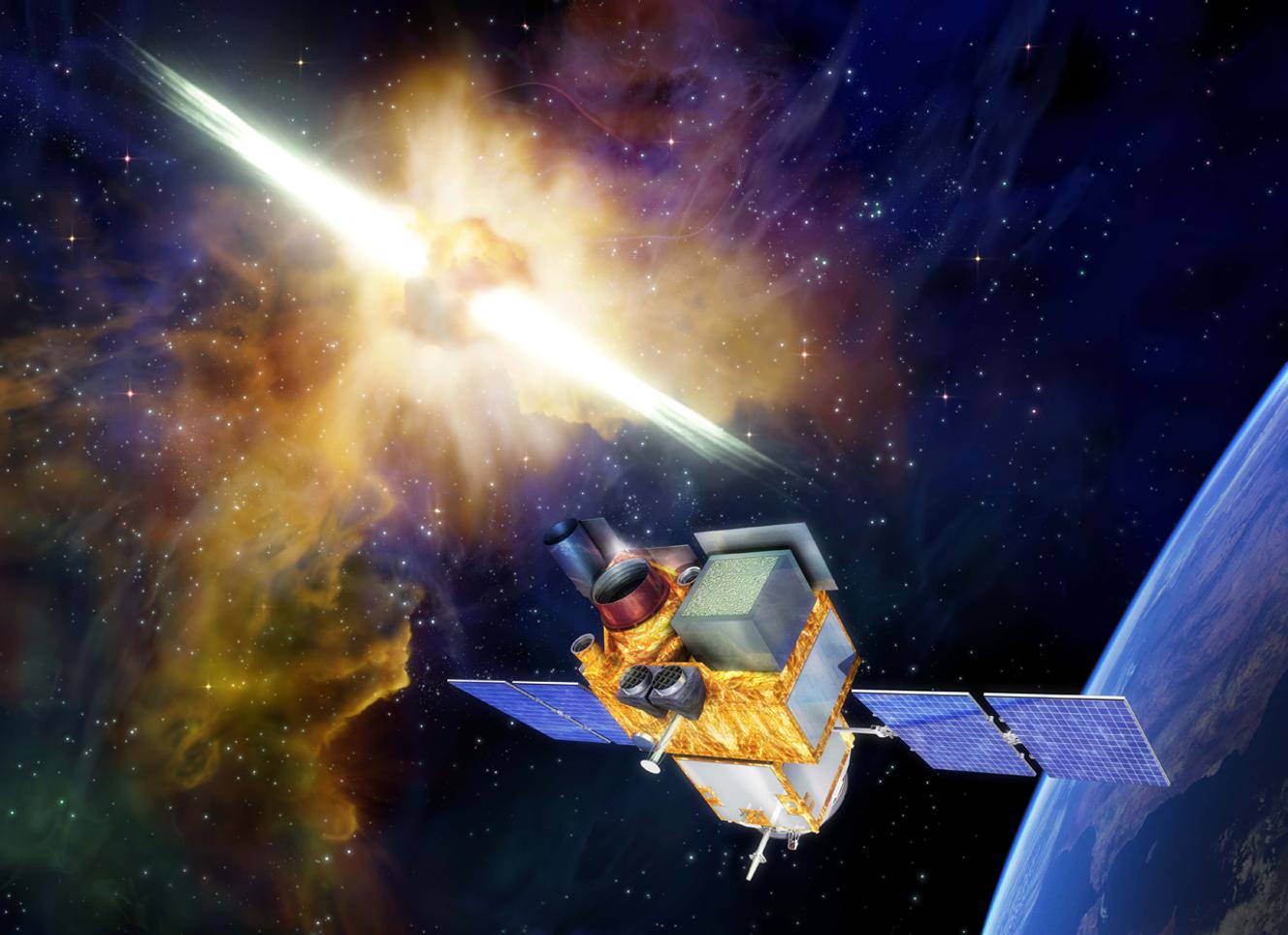Léon, 31 ans, game designer, 4 300 euros par mois : « Etre né dans une famille aisée, c’est avoir eu le droit de partir avant les autres au 100 mètres »
« La bonne paye ». Que signifie bien gagner sa vie ? Comment se projettent-ils dans l’avenir ? Léon (le prénom a été modifié) profite de dons familiaux qui lui assurent un futur serein, mais s’interroge sur les inégalités que creuse ce poids de l’héritage dans la société.

Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci.
La reproduction totale ou partielle d’un article, sans l’autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite.
Pour plus d’informations, consultez nos conditions générales de vente.
Pour toute demande d’autorisation, contactez syndication@lemonde.fr.
En tant qu’abonné, vous pouvez offrir jusqu’à cinq articles par mois à l’un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ».
https://www.lemonde.fr/campus/article/2025/08/25/leon-31-ans-game-designer-4-300-euros-par-mois-etre-ne-dans-une-famille-aisee-c-est-avoir-eu-le-droit-de-partir-avant-les-autres-au-100-metres_6634655_4401467.html
Je gagne 4 300 euros net par mois en tant que game designer dans une entreprise située au Danemark. Je participe au processus de création des jeux vidéo. Je conçois les actions que le joueur peut effectuer et je structure les règles de fonctionnement du jeu. J’ai emménagé dans ce pays nordique il y a trois ans, mais j’ai grandi à Périgueux, en Dordogne. C’était une enfance paisible et remplie de tendresse.
Ma mère est ingénieure, issue d’une famille de la classe moyenne, dans laquelle ma grand-mère a arrêté de travailler pour s’occuper d’un de ses fils, handicapé. Mon père a perdu ses deux parents dans un accident de voiture lorsqu’il était très jeune et a été élevé par ses grands-parents, selon la vieille école, dans un milieu modeste. Il n’avait pas le bac. Avec ses compétences en électricité, il a réussi à monter une petite structure de prestation scénique pour des salles de spectacles, qui a connu un bel essor. Mon père était peu présent la semaine, puisqu’il travaillait beaucoup, mais il était très aimant.
Avec mon frère, on sait que tout ce qu’ils ont construit, c’était vraiment pour nous. Nous n’avons manqué de rien, et pas seulement financièrement. Mes parents nous ont toujours accompagnés. Après le collège, j’ai eu l’occasion d’intégrer un lycée technique ayant une section arts appliqués. J’ai eu pas mal de passions, mais il en était une qui ne me quittait pas : les jeux vidéo. Six mois avant la fin de ma terminale, j’ai découvert qu’il existait des écoles qui formaient à cet univers. J’ai passé le concours de Supinfogame [aujourd’hui Rubika], à Valenciennes (Nord).
La période de l’école a été vraiment exceptionnelle. Ce ne sont pas des études typiques, mais très créatives, où on nous demandait d’être autonomes et proactifs. Dans ma promotion, la quasi-totalité des étudiants ne venaient pas du Nord : nous étions tous parachutés dans cet endroit pour vivre une passion commune, et cela nous a amenés à créer des liens ultraforts.
« Un énorme apport »
Là encore, j’ai eu beaucoup de chance que mes parents, qui gagnent un peu plus de 11 000 euros par mois à deux, financent ma formation, à 7 000 euros par an. Je vivais en colocation, moyennant un loyer de 250 euros par mois, que mes parents me payaient en plus de me donner suffisamment pour faire mes courses. Je bossais aussi l’été, à la chaîne, dans l’usine où travaillait ma mère, pour m’offrir des vacances et des loisirs.
J’ai trouvé du travail directement après l’école, aidé par les partenariats que celle-ci noue avec des entreprises. J’ai été embauché à Paris par l’un des plus grands éditeurs indépendants de jeux vidéo. Au début, je gagnais à peu près 1 700 euros net. Je suis monté ensuite à 2 200 euros net au bout de quatre ans. C’était suffisant pour bien vivre à Paris. Avec deux amis, on avait trouvé un bon plan : une maison de ville dans le 19ᵉ arrondissement, un peu insalubre mais pour laquelle le loyer s’élevait à environ 600 euros par personne.
Juste avant la pandémie [de Covid-19], j’ai acheté un studio de 25 mètres carrés à 290 000 euros, grâce au soutien de ma famille. Ce ne sont pas les 2 200 euros mensuels que je gagnais qui m’auraient permis d’acheter dans Paris. Nous avons effectué cet achat sous la forme d’une SCI [société civile immobilière] familiale, dans laquelle mon frère et moi avons des parts. Nous entrons progressivement au capital. Ce système facilitera la succession. Mes parents ont fait un énorme apport, et nous avons rénové toute une partie du studio en famille.
Mon père et ma mère ont commencé tôt à réfléchir à ce qu’ils pourraient nous laisser. J’ai un compte avec une assurance-vie, que mon père a ouvert avant ma naissance. Ce qui fait que, à 20 ans, j’avais déjà 25 000 euros sur un livret, sans avoir eu à faire quoi que ce soit. Depuis plusieurs années, mes parents multiplient les montages financiers afin que mon frère et moi puissions bénéficier de l’essentiel du fruit de leur travail en toute légalité, en faisant appel à des comptables et à des notaires. Au regard de leur histoire familiale, notamment celle – très difficile – de mon père, ils veulent s’assurer que l’on ait un filet de sécurité si jamais nous voulions nous lancer à l’aventure, voyager, monter des entreprises, ou en cas de maladie.
Je me sens à la fois redevable et mal à l’aise, car ces occasions s’offrent à moi, non pas grâce à mon travail ou à mes choix de vie, mais surtout grâce à la famille dans laquelle je suis né et à mon héritage. Aujourd’hui, une très grande partie du capital des gens provient de leur héritage familial, et c’est injuste. Etre né dans une famille aisée, c’est avoir eu le droit de partir avant les autres au 100 mètres.
« Une vraie légèreté »
Je reste étrangement angoissé par l’enjeu que représente le travail. J’ai peur d’être au chômage, en particulier dans le contexte de tension qui règne actuellement dans mon secteur. Mais il est certain que ce filet familial m’apporte une vraie légèreté quant à mes choix de vie. Je ne vivais que depuis quelques mois dans l’appartement parisien quand une bonne occasion professionnelle s’est présentée au Danemark.
A ce moment-là, la situation s’était dégradée dans mon travail, alors, malgré pas mal d’hésitations, j’ai décidé de partir, soutenu par ma famille. Là-bas, nous avons emménagé d’abord en location, avec ma copine, qui travaille comme free-lance dans le cinéma d’animation : un 55 mètres carrés, pour 2 000 euros de loyer. C’était désormais possible, puisque mon salaire avait sensiblement augmenté du fait de ce changement d’emploi.
Depuis peu, nous avons acheté tous les deux à Copenhague : un trois-pièces – peut-être pour accueillir un enfant dans quelques années –, pour lequel notre prêt nous revient à 1 200 euros par mois. L’intégralité de l’apport vient de moi, car j’ai bien plus d’épargne que ma compagne : plus de 100 000 euros de capital, en raison de donations familiales survenues au moment de la vente de l’entreprise de mon père. Nous avons passé un contrat de copropriété – elle détient 40 % des parts et moi 60 % –, mais nous avons décidé de prendre toutes les décisions sur un pied d’égalité en ce qui concerne le lieu.
Il était important pour moi de contribuer à hauteur de mes capacités, et de lui éviter de toucher à ses économies, afin qu’elle puisse conserver son autonomie en cas de séparation. De manière générale, c’est une question fondamentale dans notre couple, nos revenus étant également très différents, puisque ma compagne gagne environ 2 900 euros par mois, et a des revenus fluctuants. Nous réfléchissons à la meilleure manière de répartir le budget afin qu’elle ne soit pas trop lésée.
[Source: Le Monde]