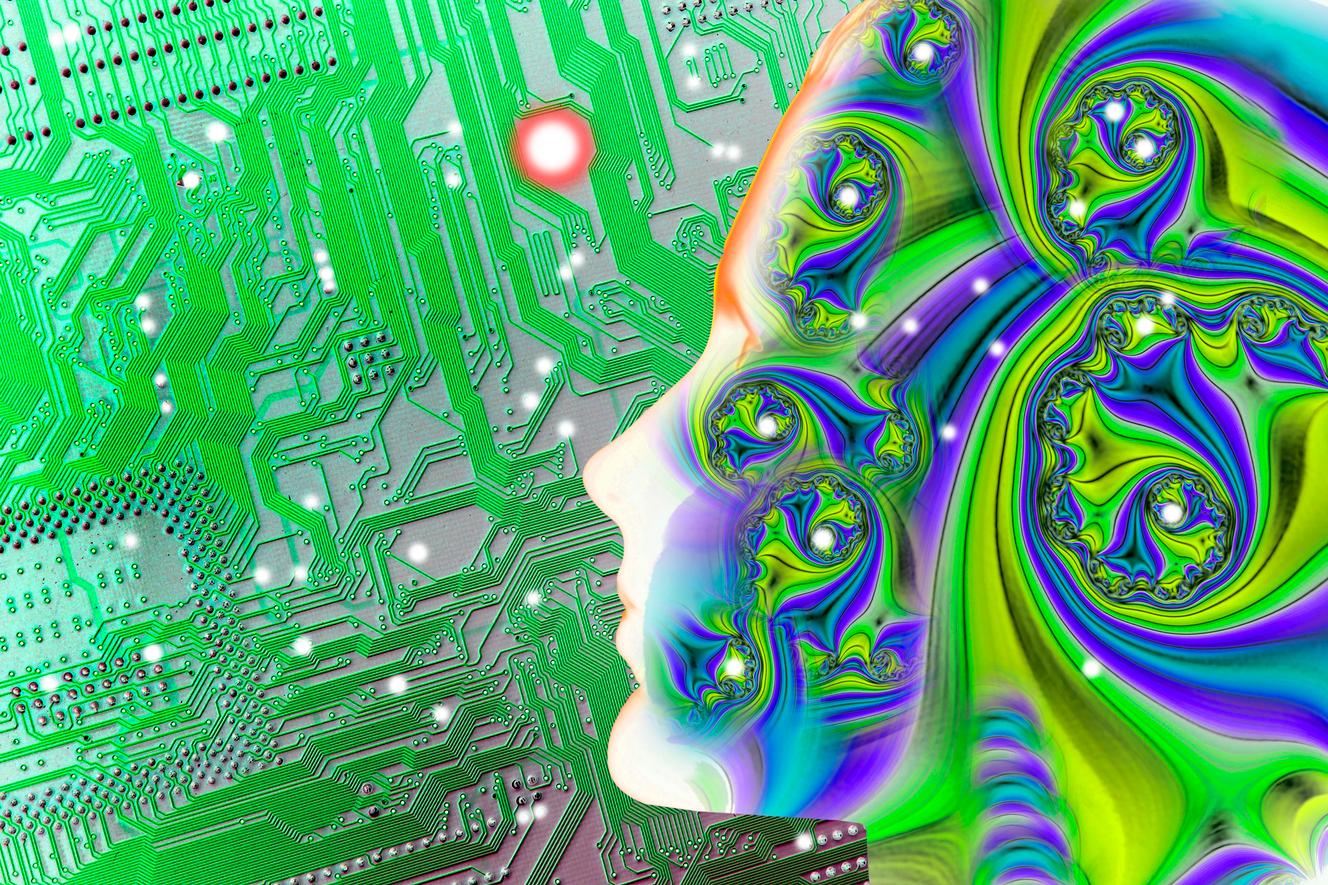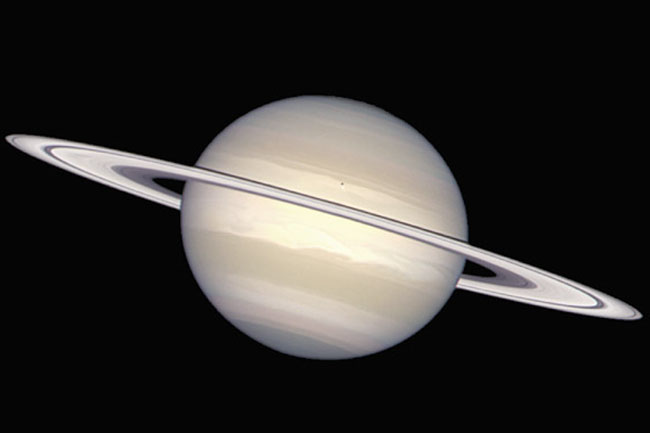Au Soudan, le royaume des « shamassa », les enfants de la guerre
« Shamassa » veut dire « enfant du soleil », mais ces gamins des rues portent mal leur nom. Devenus des proies faciles au cœur du conflit, ces orphelins sont à la merci des groupes armés. Ils racontent la guerre à hauteur d’enfant.

James a 16 ou 17 ans, il ne sait pas exactement. Aussi loin qu’il s’en souvienne, il a toujours été à la rue. Vendeur de cigarettes, cireur de chaussures, chiffonnier, ferrailleur, l’adolescent au corps svelte et aux veines saillantes a enchaîné les petits boulots. Avant que n’éclate la guerre, le 15 avril 2023, James trimait dans un restaurant, « à la plonge ou à la serpillière ». Une journée pouvait rapporter au mieux 10 000 livres soudanaises – moins de 3 euros.

Dès les premiers combats entre l’armée soudanaise dirigée par le général Abdel Fattah Al-Bourhane et les paramilitaires de Mohammed Hamdan Daglo, dit « Hemetti », – sanglant conflit qui a déjà fait quelque 200 000 morts –, James a perdu son gagne-misère et ses deux copains de galère, Sabeed et Deng, éventrés par une frappe de drone. « A part les obus qui tombaient tout le temps, la guerre n’a pas changé grand-chose, assène-t-il de son regard brillant qui ne cille pas. On n’a rien connu d’autre que la violence. »
On les appelle les shamassa, les « enfants du soleil ». Armés de chiffons, ils font briller les bagnoles de la capitale, ramassent tout ce que la ville recrache, ses ordures, ses bouts de ferraille et ses bouteilles en plastique. On les entend arriver au frottement de leurs tatanes sur le bitume, ou à leur sifflement qui propose aux passants de cirer leurs chaussures. Souvent orphelins, ils sont aussi devenus la chair à canon de la guerre soudanaise. Des proies faciles à recruter pour les milices des Forces de soutien rapide (FSR) qui ont garni leurs rangs de gamins errants.
A qui manqueraient-ils ? Les shamassa sont la horde invisible de Khartoum. Ceux que personne ne regarde, qu’on chasse d’un revers de manche. Des enfants comme James, il y en avait plus de 20 000 dans la capitale au début des années 2000. Au cours des deux années et demie de guerre, des milliers d’autres ont rejoint cette armée vagabonde. Selon l’Unicef, plus de 5 millions d’enfants ont été déplacés par les combats depuis avril 2023.
Caste exploitée
James connaît la ville comme sa poche. Elle l’a accueilli dans ses tentacules, ses terrains vagues, ses ruelles de sable. Il a traîné sous ses porches, exploré ses recoins, dormant « toujours sur un bout de carton ». Il y est né, tout au bout de la capitale soudanaise, dans un grand bidonville, à l’ouest, là où commence le désert. Pour les habitants de ce quartier bien mal nommé Dar es-Salaam (« la maison de la paix »), la guerre n’a pas commencé le 15 avril. Elle les poursuivait depuis longtemps. Dans ces banlieues lointaines, la plupart ont fui les massacres commis par les janjawids [des miliciens issus de tribus arabes], au Darfour, dès le début des années 2000 et, au sud du pays, la menace des Antonov, bombardiers du régime d’Omar Al-Bachir, qui planaient sur les territoires rebelles des monts Nuba et du Nil Bleu.
Comme James, la plupart des shamassa sont originaires de ces régions marginalisées en proie aux conflits armés depuis des décennies. A Khartoum, « les enfants du soleil » n’ont connu que les descentes de police, le vol, la drogue, la prostitution. Dédaignés de tous, sans document d’identité, ils forment une caste exploitée, humiliée, à la merci du monde des adultes. « Mon patron me traitait de nègre, d’esclave. J’étais sa chose », raconte James.
Le racisme quotidien les poursuit sans relâche. « Tu as déjà vu un Noir propriétaire d’un immeuble de quinze étages ou d’une bagnole dernier cri dans ce pays ? », s’indigne James. Au Soudan, dont le nom vient de Bilad el-Sudan en langue arabe, qui signifie « le pays des Noirs », la société distingue les différentes teintes de peau. Il y a les « Rouges », à la peau plus claire – surtout issus du nord et du centre du pays – ; et les « Bleus », à la peau mate – souvent issus des marges. Les shamassa sont de ceux-là.
Une ségrégation raciale héritée de la traite des esclaves sous l’Empire ottoman, au XIXe siècle, puis de la colonisation britannique, durant la première moitié du XXe siècle. Depuis l’indépendance du Soudan, en 1956, le système politique a continué à favoriser certaines élites du pays – souvent issues des tribus arabes riveraines du Nil – au détriment de ses marges, peuplées de communautés dites « africaines », plongées dans un cycle de conflits perpétuels. Mû par une volonté d’imposer au pays une identité arabe et islamique, le régime d’Omar Al-Bachir (1989-2019) a accentué pendant trente ans cette fracture.
Recrutés dès 14 ans
C’est dans cette faille de l’histoire du pays que les FSR se sont engouffrées. La milice paramilitaire s’est proclamée défenseur de ces marginalisés, en propageant une rhétorique mensongère. Les massacres génocidaires commis au Darfour – notamment à Al-Geneina, en janvier 2024, et à El-Fasher, en octobre 2025, qui ont fait chacun des milliers de morts – prouvent qu’ils ne sont en rien des protecteurs. Les FSR ont plutôt créé un chaos offrant à tout laissé-pour-compte une occasion de prendre sa revanche. De quoi séduire certains gamins des rues.

Si l’armée régulière enrôle parfois des mineurs dans le cadre de la « mobilisation populaire », le recrutement d’enfants soldats chez les FSR était monnaie courante bien avant la guerre. Des milliers de mineurs ont été embrigadés, de gré ou de force, dans les territoires sous leur contrôle, à l’ouest du pays. Souvent, en signe d’allégeance au clan Daglo – le leader des paramilitaires –, ce sont les chefs traditionnels qui envoient des contingents de garçons rejoindre les camps d’entraînement. Parfois, ce sont les familles elles-mêmes qui en font des soldats.
Lors de la prise de Khartoum, aux premiers jours de la guerre, James a vu de ses yeux « des tonnes de gars rejoindre les FSR. Beaucoup sont morts, d’autres sont partis avec eux », assure le garçon. A plusieurs reprises, James lui-même s’est vu proposer une arme. Il a refusé net. « Si t’en portes une, tu rentres dans un engrenage », dit-il avec une voix grave qui n’est pas de son âge.
A Omdourman, la plus grande ville du Soudan, située juste en face de Khartoum, les FSR ont recruté des shamassa, dès l’âge de 14 ans, qui n’ont pas hésité à participer au pillage de la cité. « C’est facile de les séduire. Pour ces ados qui n’ont connu que la rue, un salaire, une arme qui brille, c’est tentant. Ils deviennent des rois », renchérit Khamis Younes. Cet homme doux, d’une cinquantaine d’années, est le responsable du Markaz Mahaba, une association du quartier d’Al-Shuhada destinée à accueillir et réinsérer les gamins des rues. Le centre social en héberge une quarantaine, qui ont entre 6 et 20 ans.


On y entre par un portail bleu ciel, criblé d’éclats d’obus, qui s’ouvre sur une cour de terre battue où trônent un panier de basket branlant, une parabole hors d’usage, des tas de ferrailles et un peu de linge étendu. Une bâtisse rectangulaire comme une boîte à chaussure fait office de dortoir. Dans le vrombissement d’un ventilateur qui menace de se déboîter à chaque tour, les enfants dorment sur du nylon tressé aux barreaux d’une dizaine de lits superposés en fer.
Quand la guerre était dans la ville, c’est ici que James s’est réfugié. Il allait chercher de l’eau, poussant un baril de fer bricolé sur deux roues. En chemin, il était souvent alpagué, frappé, dépouillé, par des miliciens, parfois plus jeunes que lui, mais armés de gros calibres. Un jour, il s’est pris une balle dans la jambe. Il en garde une cicatrice rose, sous son short déchiré. « Ils étaient bourrés ou défoncés. Ils se battaient entre eux et touchaient aux filles du quartier », poursuit l’adolescent.
Avec la guerre, la came a envahi la ville comme une traînée de poudre : « bango » (cannabis), cocaïne, « Ice » (cristaux de meth), ou autres drogues de synthèse. Au nord de Bahri, ville jumelle de Khartoum, les FSR avaient leurs propres usines de captagon. A l’ouest d’Omdourman, des soldats liés à l’armée soudanaise vendent aujourd’hui des pilules et du cannabis. Pour James, c’était juste de la colle, sniffée, « pour alléger, pour oublier ».
« Bombe à retardement »
Sur la terre battue du Markaz Mahaba, les enfants apprennent des rudiments de soudure, de menuiserie ou de cuisine. De quoi travailler un peu et ramener quelques billets pour assurer les repas du centre. Depuis le début du mois de septembre 2025, une poignée d’entre eux se rend à l’école qui a rouvert au coin de la rue.


La cloche sonne et une cinquantaine d’écoliers déferlent dans la cour aux murs perforés de balles. « Ils sont tous des enfants de la guerre, certains d’El-Fasher ou du Kordofan. La plupart ont tout perdu, parfois, leur famille entière tuée sous leurs yeux », avertit Omer Ali, professeur à l’école qui était encore occupée, il y a peu, par les FSR. « Les gamins développent leur propre langage, mêlant le nom des armes, des drones et les insultes tribales. Le pays entier se transforme en une caserne militaire. Ils sont le miroir de notre société », se désole l’enseignant appuyé sur une canne.
Loin des lignes de front, la véritable « bombe à retardement », selon lui, c’est bien le manque d’éducation. Avec la guerre, plus de 14 millions d’enfants en âge d’être scolarisés sont sortis du système scolaire, selon l’Unicef. « C’est pourtant là que se joue l’avenir du pays. Au Soudan, l’ignorance est cultivée à desseins. A chaque tentative d’amener la paix, des seigneurs de guerre viennent arroser les graines semées lors des conflits précédents », analyse Omer Ali.
Rentrant au Markaz Mahaba après une journée de labeur, James s’affaire en cuisine pour préparer le repas du soir pour tout le monde. « La société nous a abandonné, à part des gens simples comme Khamis [le responsable de l’association] », balance-t-il froidement. Il est loin le temps de la révolution de 2018, quand les manifestants avaient renommé les shamassa les « héros de la rue », leur faisant classe et leur offrant de quoi manger et se couvrir. James dormait alors sous une tente, au sit-in pacifique qui avait précipité la chute d’Omar Al-Bachir, en avril 2019.


James n’est pas un révolutionnaire. Il a juste été « pris dans le truc ». Mais le garçon avait fini par espérer, comme les autres, que le Soudan allait dans la bonne direction. « Les gens ont fait tomber un régime, il est revenu. Ils ont demandé le changement, on les a ramenés trois pas en arrière. Ce pays marche à reculons », déplore James, d’une lucidité implacable. Parfois, il rêve de s’échapper en Europe – « en France pourquoi pas ? » –, traverser la Méditerranée en sumbuk, ces frêles embarcations. Parfois, il se dit que non, il ne quittera pas le Soudan. « Ce pays ne m’a rien donné, mais je n’arrive pas à le détester », dit-il sans trop savoir pourquoi. La plupart du temps, comme le reste de sa génération perdue, il ne pense pas à demain, parce que demain, c’est loin.
[Source: Le Monde]