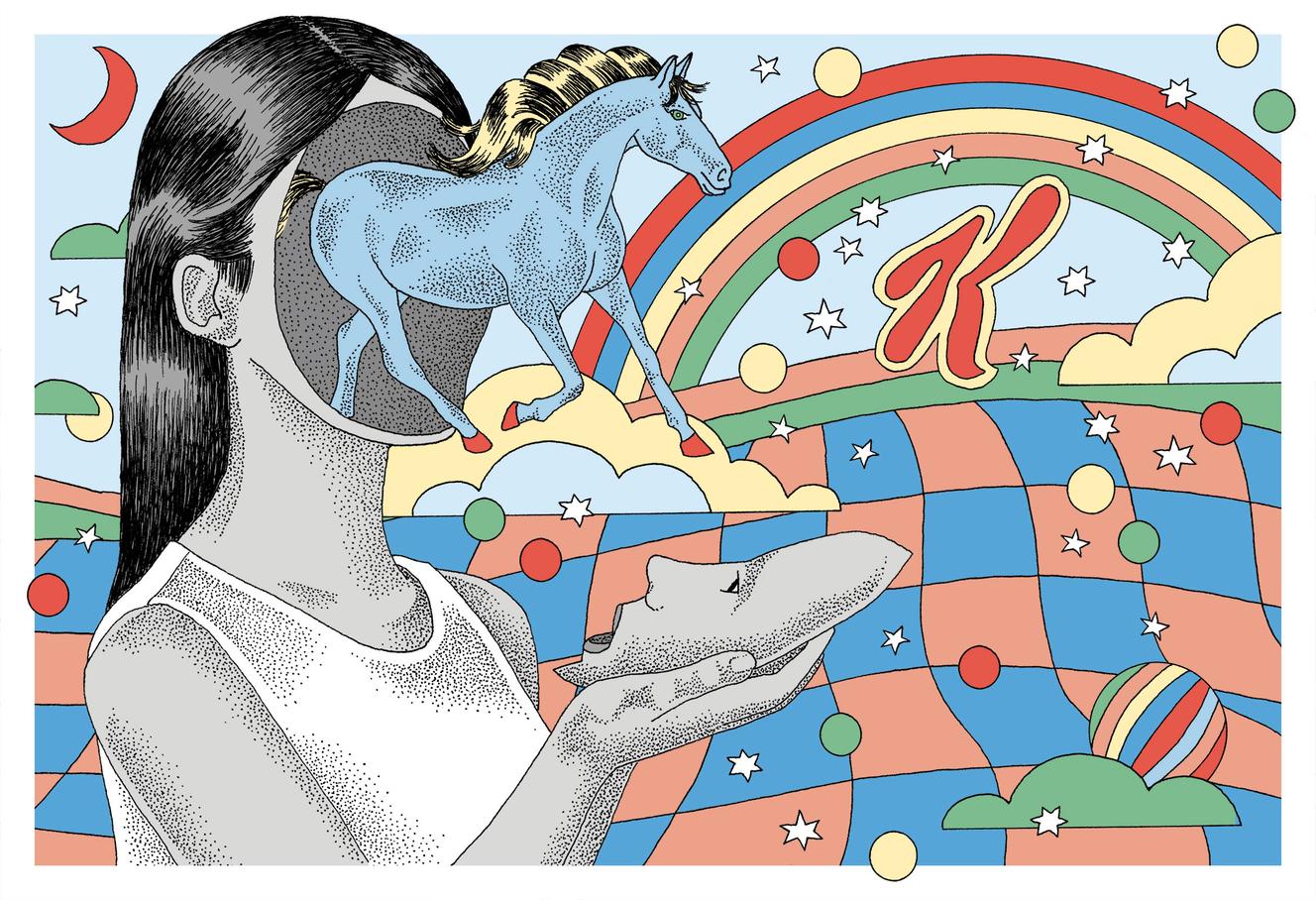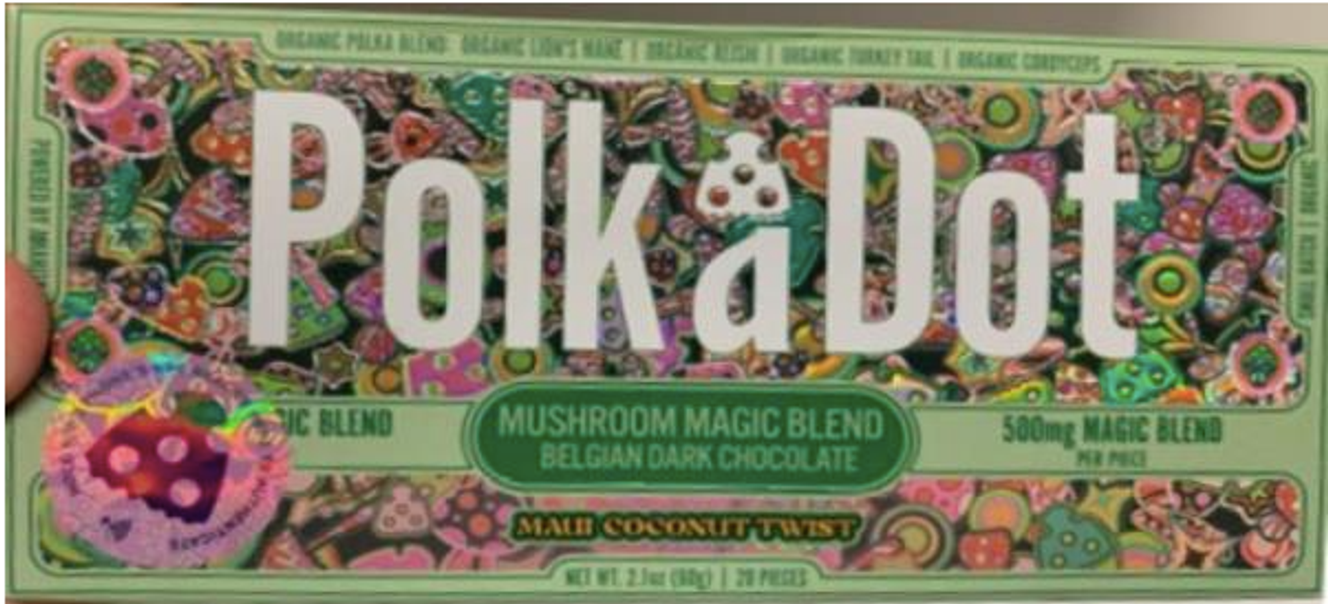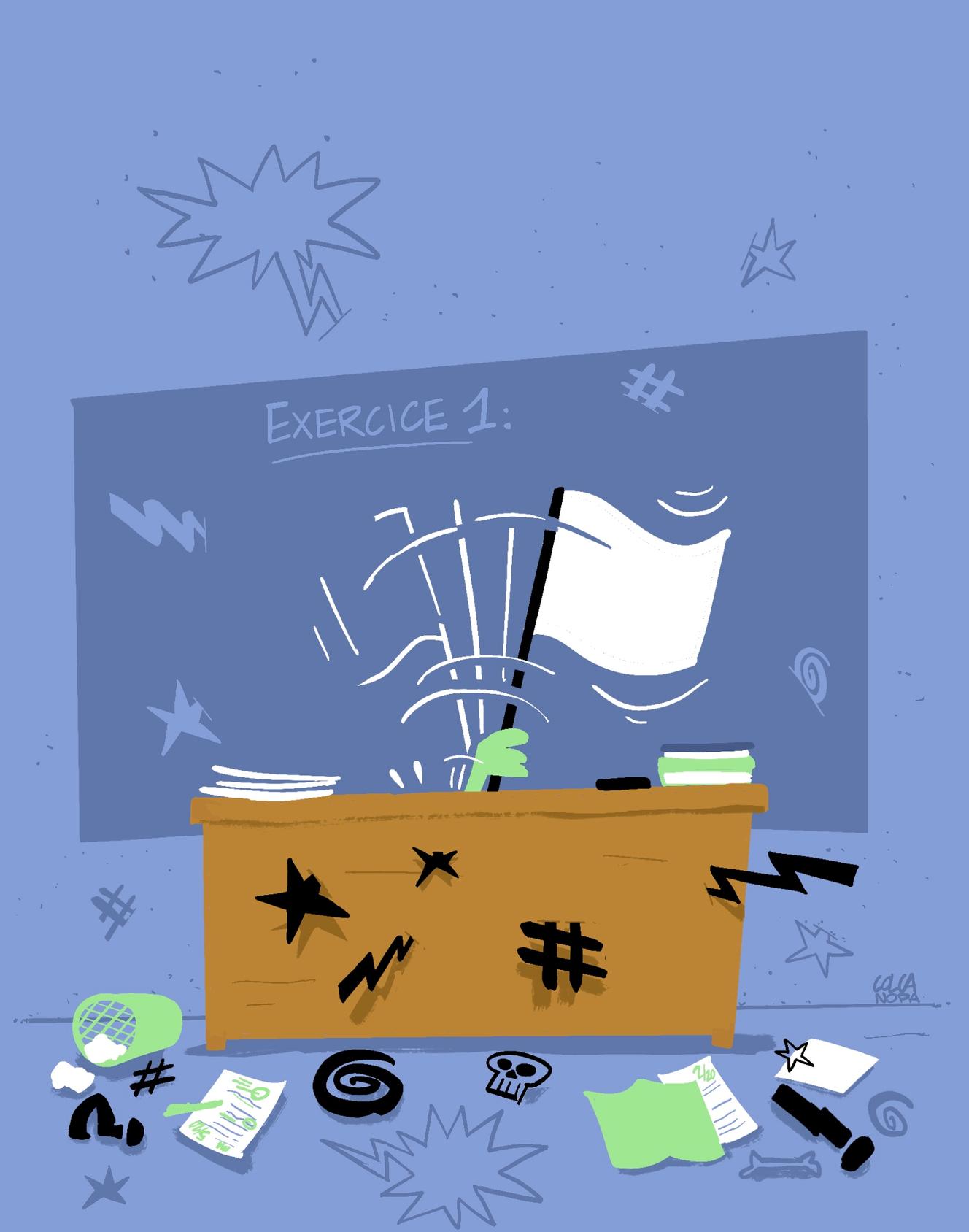Des parents face à l’addiction de leur enfant : « J’ai cette peur, ancrée en moi, qu’on m’appelle pour m’annoncer le pire »
La dépendance à l’alcool, aux drogues, la violence qui en découle… Malgré la douleur d’assister à la déchéance de leur enfant devenu adulte, des parents tentent de conserver le lien. Deux mères racontent ce difficile équilibre entre soutien et protection de soi.

C’est l’histoire d’un enfant qui, à l’adolescence et dans les débuts de l’âge adulte, teste ses limites. Les premières soirées alcoolisées, les premiers joints et les premières « défonces ». « Au début, on ne sait jamais vraiment, on se répète : “Il est jeune, c’est normal qu’il fasse la fête” », se remémore Raymonde (tous les prénoms ont été modifiés), 68 ans. Et puis vient, de manière insidieuse, un point de bascule, où la consommation n’est plus seulement récréative. « Avec mon mari, on a mis du temps à comprendre ce qu’il se passait, parce que mon fils ne buvait jamais devant nous, raconte l’ancienne employée en reprographie, qui vit en Seine-Maritime. Et puis l’alcool, le cannabis, ça change quelqu’un, son visage était marqué. »
Difficile, pour des parents confrontés à la dépendance de leur enfant devenu adulte, de trouver leur place, notamment lorsque l’alcool ou les drogues consommés ont des répercussions sur le quotidien et sur la vie de famille. Le Monde a rencontré deux mères prêtes à livrer leur histoire : Raymonde, qui a fait le choix de préserver, coûte que coûte, le lien avec son fils, et Joëlle, 66 ans, qui, elle, a cherché de l’aide auprès des pouvoirs publics avant de décider de poser ses limites.
Il aura fallu de nombreuses années avant que Raymonde ose parler de la dépendance de Bruno, 44 ans. Il y a deux ans, son fils a réussi à être abstinent plusieurs mois, avant de replonger. A cette époque, les impayés de loyer s’étaient accumulés – alors que le quadragénaire avait perdu son emploi de couvreur –, jusqu’au jour où il a été menacé d’expulsion de son domicile.
Raymonde choisit alors, en avril 2024, de l’accueillir, ainsi que ses trois enfants de 5, 13 et 16 ans, dans sa maison, en Normandie. « C’était une évidence. C’est mon fils, je n’imaginais pas une seconde le laisser dans la rue. Je ne sais pas si mon mari aurait été d’accord avec cette décision… », s’interroge à voix haute celle qui est devenue veuve il y a six ans.
« Parfois, ça me rend folle »
La sexagénaire raconte son quotidien, bousculé avec cette nouvelle configuration : les repas pris ensemble, les soirées agitées, les non-dits autour de la dépendance. Son fils a sa chambre, tandis que ses trois petits-enfants – confiés à leur père en garde alternée – partagent une même pièce, où chacun a son lit. « Bruno n’a jamais été agressif, mais il n’est pas facile pour autant. C’est d’autant plus difficile qu’il est impossible de diriger un enfant de plus de 40 ans », explique Raymonde. Elle confie son impression de ne plus être tant une grand-mère qu’un parent à part entière pour ses petits-enfants, ce qui brouille les frontières. « Parfois, ça me rend folle, quand je me lève pour emmener ses enfants à l’école alors que lui dort jusqu’à 14 heures ; quand je fais les repas toute seule ; quand je dois lui dire de ranger sa chambre, décrit-elle. Et, des fois, je suis juste morte d’inquiétude. »
A la fin du mois d’avril 2025, alors que ses petits-enfants sont chez leur mère, elle n’a pas de nouvelles de son fils pendant toute une nuit. Elle finit par apprendre qu’il est en garde à vue, après avoir été arrêté alors qu’il achetait du cannabis. « C’était une angoisse inimaginable, je m’étais imaginé le pire, j’avais appelé tous les hôpitaux de la région », souffle-t-elle.
« Je ne pourrai pas le garder pendant des années et, même pour les enfants, ce n’est pas une vraie vie », reprend la retraitée, qui peine à joindre les deux bouts avec cinq personnes à la maison et une retraite qui ne dépasse pas les 2 000 euros. « Rien de tout ça n’était prévu », poursuit-elle, retenant ses larmes. Son fils, qui touche environ 700 euros de chômage, l’aide comme il peut, mais l’essentiel de son argent va dans les dépenses obligatoires pour les enfants : le bus, le téléphone, la nourriture…
Au sein de sa famille, certains ont décidé de prendre leurs distances. C’est le cas de son fils cadet, Antoine. « Disons qu’ils se supportent, dit leur mère. Il n’y a pas de problème, parce qu’Antoine arrive à prendre sur lui. » Raymonde, elle, réussit depuis peu à prendre du recul. Il y a deux ans, elle a poussé la porte des groupes de parole Al-Anon, une association qui réunit des parents et des proches d’alcooliques. « Ça a été libérateur. On comprend qu’on n’est pas tout seul, et on apprend à s’occuper de soi », rapporte la retraitée, qui a décidé de s’inscrire à différents clubs de sport et associations, afin de s’occuper l’esprit.
« Dépasser la honte »
Al-Anon représente 135 groupes de parole dans toute la France. Les réunions se tiennent chaque semaine, par visioconférence ou en présentiel. D’autres dispositifs de ce type existent, souvent encadrés par des professionnels. Dans le 17e arrondissement de Paris, à l’hôpital Marmottan, se tient par exemple tous les mois un groupe de parole destiné à l’entourage de jeunes addicts. Comme pour Al-Anon, les réunions sont gratuites et anonymes. « L’objectif est de dépasser la honte que peuvent ressentir les parents, explique Muriel Lascaux, psychologue et coanimatrice du groupe. Ils sont amenés à parler de leur vécu. Nous ne sommes pas là pour rendre les parents aidants, mais pour les aider à accepter la situation. »
Un avis que partage Catherine Delorme, la présidente de Fédération Addiction, une association qui regroupe des organismes et des professionnels travaillant dans le champ de l’addictologie. En 2023, l’usage de cannabis dans l’année concernait 10,8 % des 18 à 64 ans, soit 14,5 % des hommes et 7,2 % des femmes, d’après l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Cette même année, la consommation quotidienne d’alcool concernait 7 % des adultes (12,6 % des hommes contre 3,8 % des femmes).
Mais il est nécessaire de distinguer les pratiques et les consommations : de quel produit parle-t-on ? A quelle fréquence ? « Ce sont ces questions que nous posons d’abord aux parents, rappelle Catherine Delorme. Il faut leur rappeler que ce sont des comportements fréquents et qu’il ne faut pas marginaliser leur enfant. Ensuite, il faut voir avec eux les situations qui nécessitent un accompagnement médical. Dans tous les cas, eux ne peuvent pas faire ce travail à la place de leurs enfants. » Elle insiste également sur l’importance, pour les parents, d’arriver à poser leurs limites, d’autant plus avec des enfants devenus adultes.
Joëlle a tenté de le faire avec son fils, Paul, 45 ans. « Je viens d’apprendre qu’une amie venait de perdre son fils d’une overdose, commence l’ancienne aide médico-sociale, émue. Il avait 28 ans, ça m’a bouleversée. Et je me suis rappelé cette peur, ancrée en moi en permanence, qu’on m’appelle pour m’annoncer le pire. »
La retraitée retrace alors le fil d’une dépendance qui s’est transmise de génération en génération, elle-même étant une ancienne alcoolique, abstinente depuis une trentaine d’années. A 15 ans, Paul commence à fumer du cannabis. Le père de l’ado a déjà pris le large depuis longtemps. Pour payer sa drogue – qu’il consomme en quantités croissantes – le jeune homme commence à commettre des vols. Joëlle fait alors appel à des professionnels : son fils est suivi par des éducateurs de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ; elle-même se fait accompagner par un psychiatre.
« J’ai décidé de le mettre dehors »
Alors que Paul a presque 18 ans, tout bascule. « Il me mentait, le dealeur venait sonner chez moi… Un jour où il n’avait pas ses clés, il a fracassé la porte du jardin et m’a volé plein de choses afin d’acheter sa consommation, raconte difficilement Joëlle. J’ai décidé de le mettre dehors pour protéger mon lieu de vie, mais aussi ses frères et sœurs [issus d’une seconde union]. Et là, je n’ai pas su ce qu’il devenait pendant quelques années. Ça a déclenché énormément de culpabilité, mais je me disais que, peut-être, une fois au pied du mur… », dit Joëlle, dont la voix se brise. « J’étais sûre qu’il demanderait de l’aide, mais ça n’a pas été le cas », reprend-elle. Elle apprend par la suite que, son fils n’étant plus mineur, les mesures de sursis pour ses vols à répétition se sont transformées en courts séjours en prison.
« J’ai essayé de lui dire de se faire aider. Moi, je ne m’en suis pas sortie toute seule, explique la sexagénaire. J’ai fait de mon mieux pour partager avec lui mon expérience, car je suis passée par là, et je sais à quel point c’est violent de se voir dépendant et de prendre conscience du mal qu’on fait autour de nous. »
Dans le film Four Good Days (2020), Molly, toxicomane de 31 ans, retourne vivre chez sa mère. On y suit les dilemmes intimes et moraux en jeu entre les deux femmes, qui tentent l’une comme l’autre de se protéger. On mesure la culpabilité qu’elles se renvoient, l’amour qu’elles se portent, mais aussi à quel point la dépendance peut tout emporter sur son passage.
A 21 ans, Paul revient dans la région Occitanie pour rendre visite à sa famille et est hébergé chez sa grand-mère maternelle. « On a appris qu’il frappait sa compagne. Ma mère et ma sœur ont assisté à des scènes de violence…, dit la retraitée, sans parvenir à finir sa phrase. Il y a eu du rejet de la part de ma famille, qui ne cessait de le traiter d’“incapable”. Moi, je pense que j’étais dans une autre position, je comprenais mieux sa maladie, sans pour autant cautionner sa violence. »
Les années passent, et Paul a un fils, Louis, en 2005. S’ensuit une période où Joëlle n’a plus beaucoup de nouvelles de son fils et de son petit-fils, qui habitent en Nouvelle-Aquitaine. La retraitée apprend, quelques années plus tard, que Louis aussi a commencé à boire et à fumer du cannabis. « Cette distance kilométrique m’a protégée, je n’étais pas confrontée tous les jours à leur polydépendance », rapporte la retraitée.
En août 2023, Louis l’appelle. Il est en échec scolaire et a été viré de son boulot de saisonnier. Il vient vivre chez sa grand-mère pendant neuf semaines. « Très vite, il a déserté la maison. J’ai essayé de mettre un cadre, mais sans succès. J’ai eu l’impression que ça ouvrait une porte sur un passé douloureux, que je ne voulais plus revivre. Il m’a beaucoup menti. Ce n’était pas possible de le garder », justifie Joëlle, au bord des larmes. Le jeune homme retourne en Charente-Maritime. Au printemps 2024, la sexagénaire apprend que son petit-fils a grièvement poignardé un garçon. Il est incarcéré depuis un an et a été condamné à trois ans de prison. « Aujourd’hui, les liens sont rompus. Je lui ai envoyé une carte de fin d’année et une carte d’anniversaire, mais il ne m’a jamais répondu », regrette la retraitée.
Elle n’a pas non plus revu son fils depuis deux ans. Après deux cures de désintoxication, il a rechuté de manière encore plus violente. « On en est là…, murmure Joëlle, qui a elle aussi rejoint des groupes de parole Al-Anon, depuis un an et demi. Lorsque Paul vient vers moi, je suis dans l’écoute et dans le soutien, mais j’ai appris à gérer mes émotions. J’essaie de garder ce lien d’amour, sans jugement, mais il est tellement abîmé par la dépendance. Le plus dur, c’est de faire le deuil de son enfant, de celui qu’on a idéalisé. On a des enfants pour qu’ils soient heureux. Il faut accepter que ça ne sera pas le cas et continuer d’avancer. »
[Source: Le Monde]